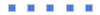

Paris reste une terre accueillant systématiquement toute sortie en provenance d'Asie. A ce niveau il est donc difficile de pinailler, à condition d’y faire le tri plutôt que de se déplacer en salles sous prétexte que "c’est asiatique donc forcément différent de la masse". Les festivals sont l’occasion de faire ce genre d’erreur, c’est parfois le prix à payer lorsque les synopsis gentiment mis à disposition par le site officiel du festival ne font que deux lignes tout au plus. Ou les joies d’une programmation douteuse, comme ce fut le cas avec Un Coeur d'or de Liu Xin, oeuvre amusante à peu près sans intérêt pour le spectateur occidental désireux de voir ce qu’il se passe en ce moment dans le mainland. Les quelques claquements de siège confirmèrent la réaction du public face au film, dont certains évacuèrent la salle dix minutes avant la fin, persuadés que Un Coeur d'or allait s’étirer plus encore. Pourtant, ce déferlement de bons sentiments pas tout à fait calqués sur la réalité du terrain étaient les seuls rayons de soleil pouvant illuminer les tristes mines d’une journée. Pas grand-chose à sauver ailleurs, il faut bien le reconnaitre. On en parle plus longuement ici.
Le dépaysement, il fallait aller le chercher du côté de Ganglamedo. Nichée dans les magnifiques terres du Tibet, l’œuvre de Dai Wei immerge le spectateur dans une sorte de bulle dont il est difficile d’y sortir, et ce dès le générique d’introduction et ses images qui flattent la rétine. Plus que son histoire tournant autour d’un voyage symbolique de An Yu, une jeune femme devenue muette en quête de voix/voie, Ganglamedo tombe dans les tréfonds du sentimentalisme alors qu’il n’en avait pas besoin : l’homme tibétain qui est censé l’accompagner jusqu’au lac sacré s’éprend alors d’un amour véritable pour elle et semble même la connaître depuis longtemps. Le film s’ouvre alors vers le mysticisme et le légendaire, au travers de flash-back lumineux détenteurs des clés sur le mystère entourant ces deux personnes qui s’avèrent être au final étroitement liées. Superbement mis en image par Dai Wei, une ancienne clippeuse, le film peut en revanche paraître rapidement indigeste pour quiconque ne supporte pas cette vitrine un peu clichée des « films du monde », de par ses images montrées et montées comme un immense clip, sorte d’accumulation de scénettes trahissant l’espace-temps, le temps de danses folkloriques locales et de passages contemplatifs qui surviennent sans crier gare. Heureusement Ganglamedo ne reste pas perché sur son sommet inaccessible en distillant de vraies notes d’humour dans cet océan quelque peu mièvre, comme lorsque An Yu se fait ligoter par son protecteur d’un temps, de peur qu’il lui arrive quelque chose sur le chemin qui la mènerait au lac. En montrant un visage du Tibet teinté de mysticisme et de traditions faisant la part belle aux joies du cœur et du corps, Dai Wei aura réussi à moderniser le tout pour le rendre accessible sans être non plus d’une immense valeur cinématographique, le film pêchant par un fil conducteur convenu malgré la rigueur de sa plastique. A noter que les projecteurs de la salle se sont miraculeusement allumés pendant plusieurs minutes en pleine projection, permettant à ma voisine de gauche de trouver son chemin vers la sortie. Il est aussi drôle de voir combien les spectateurs peuvent être déstabilisés par un si petit accident : grognements, chuchotements, têtes retournées en direction du projecteur, interrogations. Le film, lui, continuait de tourner sans problèmes.
Dans la foulée, le festival présentait dans une salle pleine à craquer –certaines personnes étaient même assises à-même le sol- le dernier film du célèbre cinéaste Feng Xiaogang. Célèbre en Chine car habitué du Box Office local, et pouvant se venter d’avoir réalisé le film le plus vu de 2008, à savoir l’intéressant La Perle rare, également connu sous le titre de If You Are the One. Starring Ge You et Hsu Qi, on y raconte l’histoire de Qin Fen, un homme incapable de trouver chaussure à son pied question amour. Ce dernier a beau organiser des rencontres à un rythme effréné, personne ne lui convient : lorsque ce n’est pas une jeune femme enceinte désirant un père pour ses enfants, c’est une femme d’affaire terrible qui lui parle finances. Ne parlons pas non plus de cette enfant venant d’une minorité ethnique chinoise –et vêtue d’un habit traditionnel- qui appellerait son cousin pour venir lui casser les jambes en cas de divorce. Qin Fen a qui plus est la malchance de tomber sur celle qui lui conviendrait, la belle Xiaoxiao, mais cette dernière a encore le cœur pris ailleurs. Les premières rencontres se solderont par un échec avant qu’un concours de circonstances les amène à passer du temps ensemble et à mieux se connaître. Au départ méprisante, Xiaoxiao révèlera un côté plus tendre. Les deux personnes vont alors conclure un marché, celui d’être officiellement ensemble au cours d’un voyage à Hokkaido, sans l’être réellement. Les mystères insondables de l’être humain sont alors passés à la loupe par Feng Xiaogang, délaissant le blockbuster à succès pour s’orienter vers la comédie romantique moderne, simple, mais rendue complexe par la qualité de son écriture et de ses dialogues.

Ge You et Hsu Qi dans La Perle rare (Feng Xiaogang, 2008)
Film de fiction par excellence, inutile d’affirmer la volonté du cinéaste de faire évader les spectateurs vers une Chine utopique, reluisante et accessible à toutes les catégories sociales. Film tendance, on y porte des t-shirts G-Star, utilise des téléphones dernier cri et l’on pose dans les plus beaux endroits du pays comme l’on prendrait un café au bord d’une terrasse quelconque. Ils n’ont clairement pas les mêmes valeurs pour reprendre un slogan publicitaire, publicité également affichée tout du long : téléphone, compagnie aérienne, automobile, chacun a droit à son petit coup de pub glissé avec soin. Le film populaire qu’il est se mue alors en film de luxe, qui se permet également de donner des leçons. Critique des capitalistes véreux concluant ici les marchés par la technique enfantine du pierre-feuille-ciseaux, critique des mœurs traditionnelles et modernes avec la crise économique en filigrane histoire de faire passer tout cela, mais traité évidemment avec humour. Le nombre sidérant de rires en cours de projection confirme la volonté manifeste du cinéaste de parler social en y apportant une touche personnelle que l’on retrouve dans la finesse des dialogues, très écrits, plus que dans les situations en elles-mêmes, au final banales et sans saveur particulière. Parfaitement lustré dans sa première partie, le film finit par se lâcher lors d’un périple cocasse au Japon basculant, de manière paradoxale, vers le pur mélodrame. Pourtant, ce voyage réserve des instants hilarants, comme lorsque Xiaoxiao, Qin Fen et son ami expatrié passent leur soirée dans l’auberge des Quatre Sœurs, ou alors lorsque Qin Fen se confesse des heures dans une église catholique perdue au milieu de nulle part, face à un prêtre qui n’en peut plus. C’est pour ces instants fugaces que La Perle rare mérite d’être vu. Le film confirme Feng Xiaogang comme un cinéaste important, mais en flattant le pays par son accumulation de petits privilèges destinés à une classe sociale huppée, il perd en générosité ce qu’il gagne en fausseté.
La générosité d’un Painted Skin y est quand à elle clairement affichée pendant les presque deux heures qui constituent le métrage. Bien qu’il ne soit jamais à la hauteur de la légende qui y est contée, le divertissement s’avère naïf, parfois poussif, mais souvent plein de vitalité et de fantaisie. Il réussit l’exploit d’être néanmoins décevant à cause d’une enveloppe cheap rappelant par moment le travail consternant réalisé sur la légende des papillons amoureux par Jingle Ma avec Butterfly Lovers en 2007, adaptation minable si l’on repense au classique Love Eterne de Li Han-Hsiang (1963) ou encore au superbe The Lovers de Tsui Hark (1994). Bousillant le moindre enjeu dramatique à cause d’acteurs à côté de la plaque et d’une musique, en dehors du beau thème principal, également hors-sujet et à la production digne d’un mauvais téléfilm, reste que le film prend une toute autre ampleur à partir du moment où l’amour des deux femmes –l’une démon, l’autre humaine- pour le même homme, est à son summum. Prête à tout pour prouver son amour à Wang, Peirong (Vicky Zhao) acceptera d’être empoisonnée par Xiaomei (Zhou Xun) afin de se faire passer par la femme démon que tout le monde recherche.

Vicky Zhao et Zhou Xun dans Painted Skin (Gordon Chan, 2007)
Le film prend alors des allures de formidable tragédie fantastique, et Zhou Xun, maculée de blanc, terrasse le spectateur par son incroyable beauté. Les yeux sont emplis de larmes, la caméra délire, le court combat de mêlée final se montre enfin d’une vraie justesse, bien loin de ces scènes d’action mal découpées et chorégraphiées parsemant le film jusque là, n’arrivant même pas à la cheville d’un Seven Swords de Tsui Hark, dernier grand wu xia en provenance des terres du milieu avec pourtant le même Donnie Yen. Un mot sur sa performance, difficile de croire au piètre sous-guerrier qu’il interprète après avoir donné des leçons –de vie et de combat- dans l’impressionnant Ip Man de Wilson Yip (2008), rôle de toute autre envergure. Sous-utilisé comme rarement –avant de réapparaître à l’écran comme par magie dans le dernier acte, seul Zhang Yimou avait fait pire avec Hero. Reste la belle poésie de la scène finale, le talent de Zhou Xun qui livre là une performance de haute tenue –et c’est bien la seule, et un semblant de légende qui sur le papier laisse hélas davantage de place à la bouffonnerie (comme ce personnage de démon homme, ridicule) qu’au mystique. Divertissant –lorsqu’il arrête de bavarder- à défaut d’être réussi. Récompensé pour sa photographie au dernier Hong Kong Film Awards. A ce propos, le grand chef opérateur mais également récent cinéaste Gu Changwei voyait son dernier film, Le Premier souffle du printemps, sélectionné pour l'occasion. On en parle ici.
Etape d’une vie d’un adolescent devenu très vite adulte, Le Fusil de Lala et son réalisateur présent pour l’occasion auront honoré le festival le temps d’une clôture qui vit l’organisation remerciée à plusieurs reprises. Deanna Gao, peintre calligraphe et présidente du festival, offrira avec un cortège de jolies demoiselles vêtues d’élégants qipao modernes, un bouquet de fleurs aux principales collaboratrices de l’évènement, dont Marie-Claire Kuo (écrivaine, réalisatrice, organisatrice en 1984-1985 d’une rétrospective de 140 films chinois au centre Georges Pompidou…) et Luisa Prudentino (sinologue et pionnière dans les recherches sur le cinéma chinois) qui auront toutes deux apporté des informations au public avant plusieurs projections. Avant de clore cette première partie, un rapide mot sur l’ambiance du festival. Au départ timide, l’influence se fera au fur et à mesure plus importante, surtout pour chaque dernière séance. La Perle rare et Le Fusil de Lala –diffusé dans une salle bien plus grande- afficheront pratiquement complet tandis que les films moins intéressants verront une partie du public s’en aller, ce fut par exemple criant pour Un Cœur d’or de Liu Xin. Enfin, on a très fréquemment noté des projections plus ou moins dérangées par le retard de certains spectateurs, arrivant parfois en plein milieu d’un film, ce qui a eu le don d’agacer de vieux aigris qui n’ont pas hésité à le leur faire remarquer en faisant voler quelques mots doux, sans la moindre gêne. Édifiant, mais pas si surprenant lorsque l’on connaît le public parisien. Au final, cette quatrième édition du Festival du cinéma chinois de Paris aura livré de beaux instants malgré une sélection inégale de films d’aujourd’hui ; cette année, l’immanquable avait 70 ans d’âge.
A suivre : Compte rendu du 4ème Festival du cinéma chinois de Paris : l'animation et le cinéma chinois d’hier.
Mes remerciements à Nathalie Iund.
Un grand merci également à Pauline et son assistante Yingzi, pour leur gentillesse et leur disponibilité sans faille.
