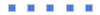L'impressionnante maîtrise formelle ne masque pas un vrai foutoir
Après un silence forcé, le peu prolifique mais précieux réalisteur Jiang Wen revient sept ans après son dernier film, récompensé du Grand Prix au Festival de Cannes 2000, dans un registre à la fois décallé mais pas franchement opposé au style opéré dans Devils on the Doorstep (2000) car
The Sun Also Rises est avant toute chose un véritable opéra de n'importe quoi et de grand guignolesque assumé avec un certain toupet. Sur le papier, le film est fragmenté en trois histoires bien distinctes (si ce n'est plus) et le cinéaste fait en sorte à ce qu'elles se rejoignent plus ou moins sans forcément s'unir dans la logique à la fois temporelle et spatiale. Le film débute donc avec une mère et son fils, dans une province de Chine continentale. La mère est malade, incontrôlable et cause de grands soucis à son fils (Jaycee Chan) obligé de veiller sur elle pour qu'elle ne tombe pas d'un arbre ou qu'elle détruise le périmètre dans lequel ils vivent. Changement d'époque, on retrouve Liang (Anthony Wong) et Tang (Jiang Wen) dont le premier est mêlé à une affaire de tripotage de fessier sur Lin, infirmière déjantée et follement amoureuse. La scène a eu lieu durant la projection d’un vieux film musical en plein air, comme il était coutume dans les années 70. Cette partie s’oriente principalement sur cette affaire, creusant ainsi un certain écart entre le prologue du film et ce qui va suivre, naturellement. La troisième partie met l’accent sur un trio amoureux en pleine campagne chinoise opposant le « fils » de la première histoire, Tang et sa femme. Autant dire que le cinéaste va s’amuser à détourner tous les codes possibles et inimaginables sans forcément garder toutes ses plumes au bout du compte. Malaise.


Malaise ? Sûrement, et de manière involontaire. The Sun Also Rises est un film malade, contagieux et particulièrement déstabilisant pour quiconque habitué au cinéma populaire chinois plus ou moins récent, lacrymal ou évitant d’une quelconque manière toute forme de prises de risque. Jiang Wen s’en fiche éperdument et bouscule la donne par son récit d’une grande intelligence à la fois narrative et visuelle, mais qui donne cette désagréable sensation de transporter le spectateur où il le désire tout en s’en fichant éperdument. Ainsi, si le film démarre dans un cadre d’une grande beauté visuelle, naturelle au possible, il passe à un cadre étriqué et poisseux (l’hôpital, lors du second acte, et ses éclairages glauques), puis s’ouvre une nouvelle fois vers la nature dans une forêt tantôt illuminée (les parties de chasse, gonflantes) tantôt brumeuse (après l’adultère de la femme de Tang), comme si le cinéaste voulait à la fois faire passer l’inquiétude aussi bien sur le plan écrit que visuel. Toutes les émotions et les caractères changeants de l’œuvre sont immédiatement retranscrits par le biais de sa caméra : plans larges à la pelle, couleurs vives, scope sur épaule, grands angles en veux tu en voilà, mise en scène alarmante car le film l’est aussi (logique, donc), travail sur la lumière grandiose, montage d’une rapidité confondante. Bienvenue chez les fous.


Mais toute cette vitalité, cet esprit festif, cette volonté de fendre le rythme peut laisser le spectateur sur la touche : l’interminable dialogue entre Lin et Liang dans la chambre d’hôpital est aussi fatiguant visuellement (gros plans à la pelle, lumière de dehors clignotante) que d’un intérêt scénaristique limite, le personnage blasé d’Anthony Wong n’aidant pas non plus de ce côté-là, ensuite tout est une question de goût, mais le matraquage d’éléments que l’on retrouve régulièrement (le son de la trompette de Tang, insupportable, les parties de chasse, le séquences comiques d’un goût douteux) finit par fatiguer. Il manque une stabilité, un lien plus fort entre les trois (voir quatre) parties, une osmose générale. The Sun Also Rises marquera d’ailleurs sûrement pour ses audaces de style plutôt que pour son intérêt intrinsèque : le film est bien cadré, c’est une évidence, comme il est tout aussi bien monté. La musique de Hisaishi Joe est parfois superbe malgré quelques passages à vide sérieux. Mais dans l’ensemble, il faudra faire preuve de motivation pour se sentir concerné par ce qui se dit et s’y passe : la « mère » du début casse des assiettes par terre, c’est rigolo, et alors ? Liang finit pendu et alors ? Le « fils » aime la femme de Tang, et alors ? Ne pas intéresser le spectateur est sûrement la pire chose qui peut arriver à un cinéaste qui n’a plus rien à prouver aussi bien devant que derrière la caméra. On ne rechignera pas devant la belle poésie formelle d’ensemble, ses quelques élans furieux d’une noirceur redoutable (la fête nocturne en fin de métrage) mais quel dommage de se demander où le réalisateur a voulu en venir durant ces deux longues heures.
Oui... et... ???
Le Soleil se lève aussi se présente sous forme d'un patchwork iconoclaste de plusieurs histoires emboitées l'une après l'autre, possédant plus ou moins de liens entre elles, et formant au final un ensemble certes bon techniquement mais vain dans sa globalité.
La réalisation comme la direction d'acteurs tirent clairement le film vers le haut, seulement cette succession de sketchs serait 100 fois plus digeste en moyens métrages qu'en un long qui se veut non-sensique et qui donne surtout une sensation bordélique, poussive, assez fatigante.Une jolie et intéressante déception.
Insupportable 
Quand bien même Jiang Wen aurait-il fait preuve d’une certaine subtilité dans sa mise en scène plutôt que de s’acharner à faire montre d’une virtuosité finalement toute relative, encore aurait-il fallu que son récit soit un minimum structuré pour qu’en ressorte autre chose que le sentiment d’avoir visionné une œuvre finalement vaine et pénible sans les clés que seul l’auteur semble posséder.
Le soleil se couche aussi 
Incompréhensible
Un tandem Jiang Wen / Joe Hisaishi, sur le papier, ça avait de quoi exciter : l’acteur-réalisateur chinois avait signé en 2000 l’un des films asiatiques les plus importants de la décennie (Les démons à ma porte), faisant preuve d’un talent tant visuel que narratif inouï doublé d’un parti pris politique jubilatoire ; quant au compositeur, on ne le présente plus.
La déception est bien sûr à la hauteur des espérances et des exigences naturelles de tout cinéphile envers Jiang Wen. Le principal reproche ? Le film est incompréhensible. Bouillonnant, inventif par moments, mais totalement décousu, tel un grand bazar où l’on aurait entassé tout et n’importe quoi sans aucun souci de cohérence scénaristique ou thématique. J’apprécie pourtant les intrigues à tiroir type Lynch, mais Le soleil se lève aussi semble si brouillon et sans queue ni tête que tout effort intellectuel pour tenter de raccrocher les morceaux laisse les bras ballants.
L’impression de coquille vide est d’autant plus ressentie qu’il n’y a ici plus aucune dimension politique (et donc polémique) qui faisait la force de son précédent métrage. L’histoire se déroule pourtant aux environs de la mort de Mao (septembre 1976), augurant un des plus radicaux changements de cap idéologiques de l’empire du milieu, passant d’un communisme qui a échoué sur toute la ligne à un capitalisme autoritaire. Or, mis à part de rares évocations en filigrane (« c’est pour la communauté, tu as un point »), c’est le désert.
Insupportable
Tout cela ne serait rien si le film n’était pas de surcroît insupportable de bout en bout. Dès les premières images et ce ballet indigeste mettant en scène un arbre, une folle avec des chaussons rouges et un perroquet numérique immonde qui crie « je sais, je sais », j’ai failli me lever de mon siège et quitter la salle. Le reste du film étant de la même trempe, à savoir des parties de chasse à coup de clairons irritantes à souhait, des coups de téléphone cochons (hommage au père Noël est une ordure ?) déviant vers une partie de pelotage de fesses stupéfiante de bêtise, ou encore cette atroce scène finale braillant à qui mieux mieux « Aliocha ! » pour un lever de soleil, on termine la séance sur les rotules en se disant que si on a tenu devant ça, alors plus aucun film de 3h en N&B avec de longs plans fixes sans paroles ne nous fait peur !
Dans l’affaire, on a oublié Hisaishi : prestation passable, peu inspirée, bruyante au début, discrète la plupart du temps. On a aussi oublié les acteurs : noyés par un montage écœurant digne d’un Jean-Marie Poiré, ils font pâle figure dans ce naufrage collectif.
Car oui, c’est un naufrage. L’un des plus énormes ratages de ces dernières années. N'est pas Kusturica qui veut !
Jiang Weng pète le feu
Il aurait fallu sept ans pour l'acteur-devenu-réalisateur Jiang Wen de revenir derrière la caméra…et il sen serait du temps et des moyens. Interdit de tournage pour avoir montré son précédent "Démons à la porte" sans l'aval des autorités chinoises, il lui aura fallu deux années supplémentaires pour concrétises sa nouvelle folle vision; car "Sun also rises" (le titre chinois original, "Le soleil se lève comme tous les jours" est beaucoup plus juste) déborde de créativité et d'une énergie (nombriliste) difficilement contrôlée.
A la base assez simple, Jiang décide de brouiller pistes et structures traditionnelles en proposant un drôle de montage. Les différentes histoires s'entremêlent sans se distinction; parfois même dans un même plan continu. On revient sur un épisode du passé pour mieux repartir dans un proche avenir, alors que l'attention du spectateur est encore entièrement focalisée sur le présent. Difficile de comprendre tous les enjeux, tenants et aboutissants à la première vision.
Surtout que le film regorge également de souvenirs et d'impressions propres au réalisateur, dont il ne donne pas forcément les clés. Reste alors à se laisser emporter dans le tourbillon de forts sentiments et d'images, à l'instar de la dernière partie sous forme de rêve (cauchemardée du studio des effets spéciaux français, Dubois) fortement inspirée des films de Kusturica (décidemment très en vogue dans l'univers des réalisateurs asiatiques contemporains, après le "Into the faraway sky" d'ISAO).
Dommage seulement, que l'exercice semble parfois trop appliquée, à la limite même de la prétention. Il faudra sans aucun doute plusieurs visions et quelques explications de la bouche même du réalisateur pour appréhender entièrement son film.
belle déception
On peut certes sentir l'influence slave et Kusturica dans le nouveau film de Jiang wen, débordant d'énergie à certains moments, et aux émotions très contrastées. Mais là ou le réalisateur s'enlise c'est dans son scénario, sa construction et ses personnages. Arrivé au milieu du film je n'étais déjà plus pris par le film qui n'a pas l'immédiateté de Kusturica. Evidemment il y a des bonnes choses aussi, d'abord une esthétique vraiment bien travaillée, des très beaux plans, ( son chef op est doué!), un casting vraiment bien dirigé (Jaycee CHAN est une révélation pour moi), mais ça ne suffit pas, et JIANG Wen n'atteind pas la meme réussite que sur "les démons à ma porte". Evidemment le film respire la liberté, mais le scénario méritait vraiment d'etre retravaillé. Ce qui rassure c'est que JIANG wen n'est rentré dans un moule quelquonque et qu'il a gardé sa "liberté de filmer".