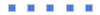Oeuvre mineure mais très souvent intéressante
Bien que trop courte pour examiner de près les rapports des différentes classes sociales, l'oeuvre d'Oshima, première, n'a pas la grandeur de ses films de la toute fin des années 60 début 70 ni même le pouvoir contestataire de son troisième film L'enterrement du soleil pas forcément supérieur mais plus engagé d'un point de vue politique et social. Mais Une ville d'amour et d'espoir, titre ô combien utopique, tisse le portrait d'une jeunesse perdue si elle n'est pas aisée, d'une jeunesse perdue si elle ne joue pas le jeu de la franchise (Masao faisant de l'escroquerie avec ses pigeons). Le film d'Oshima est alors intéressant dans son constat, froid et guère humaniste, intéressant dans la peinture de gens que tout oppose malgré l'âge qui les rassemblent (Masao et Kyoko), et sans concession d'un point de vue strictement social, le cinéaste ne nous épargnant pas de nombreuses vues sur les ghettos implantés dans la ville. Pour un premier essai, Oshima choisit bien ses interprètes et ce mélange éclectique (si certains ont déjà collaboré avec Ozu ou Kinoshita, d'autres sont de parfaits inconnus) nourrit son oeuvre, la rend attachante car imprégnée d'une sensibilité à toute épreuve. Belle performance à mettre à l'actif de Tominaga Yuki (Kyoko) et du jeune Fujikawa Hiroshi et ses faux airs de Wada Koji débutant. La séquence de bagarre improvisée sous la pluie possède déjà le parfum des films plus rentre-dedans du cinéaste, L'enterrement du soleil à titre d'exemple.
La thématique des pigeons, vraie/fausse liberté, est la métaphore du cercle vicieux et de l'incapacité d'évoluer, d'aller vers de nouveaux horizons, puisque le statut social ramène immédiatement à la réalité, au foyer taudis (le pigeon retournant à son nid). Par sa belle réalisation (plans biscornus en fin de métrage) et sa critique du fait qu'il est impossible de casser les barrières sociales, Oshima possède déjà les bribes de son cinéma, audacieux et contestataire, parfois provocateur. Il est souvent question de crimes, d'impossibilité d'échapper à son sort, de noirceur premier degré et d'échec sentimental/professionnel, ces thèmes pointent le bout de leur nez et ne finiront pas de provoquer un léger séisme dans le paysage cinématographique nippon et mondial dans les années à venir.
Abandonne tout espoir...
 Si Street of love and hope est un premier essai se distinguant dans la production d’époque de la très conservatrice Shochiku, il demeure néanmoins très loin du coup d’éclat Contes Cruels de la jeunesse de l’année suivante. Un propos, un traitement à contre courant du cinéma social japonais de l’époque sont déjà là mais l’audace n’a pas encore vraiment pris la place qu’on lui connaîtra ensuite chez le cinéaste. Car si les cadrages évitent le piège de l’esthétisant la mise en scène faite de longs passages contemplatifs, de très peu de mouvements de caméra franchit la frontière entre économie d’effets et platitude. Le refus du sentimentalisme, la retenue sont portés par ces parti pris formels mais c’est au prix d’un manque de rythme. Reste dès lors un regard noir sur les rapports de classe tranchant avec l’idéalisme alors en vogue dans le cinéma japonais. La rencontre entre l’institutrice et le vendeur de pigeons semble au début pleine de bons sentiments, de naïveté. Et l’institutrice croit rendre service au jeune garçon en lui apportant son soutien moral comme sa compassion. Mais progressivement l’abîme les séparant va crever l’écran. Car si elle compatit pour lui elle ne le comprend pas pour autant. Ce qui les sépare : compassion pour la misère et morale conventionnelle d’un coté, la survie comme seule morale de l’autre. Et d’objet de rapprochement le pigeon va progressivement devenir objet de discorde. Le tout débouchant sur une fin de film plus rythmée, multipliant les grands angles malaisants et une séquence finale scellant l’impossibilité de réconciliation entre classes sociales favorisées et classes sociales défavorisées. Et elle donne au titre du film toute son ironie. Seule partie un peu audacieuse formellement du film, elle porte des promesses de grandeur vite tenues par Oshima.
Si Street of love and hope est un premier essai se distinguant dans la production d’époque de la très conservatrice Shochiku, il demeure néanmoins très loin du coup d’éclat Contes Cruels de la jeunesse de l’année suivante. Un propos, un traitement à contre courant du cinéma social japonais de l’époque sont déjà là mais l’audace n’a pas encore vraiment pris la place qu’on lui connaîtra ensuite chez le cinéaste. Car si les cadrages évitent le piège de l’esthétisant la mise en scène faite de longs passages contemplatifs, de très peu de mouvements de caméra franchit la frontière entre économie d’effets et platitude. Le refus du sentimentalisme, la retenue sont portés par ces parti pris formels mais c’est au prix d’un manque de rythme. Reste dès lors un regard noir sur les rapports de classe tranchant avec l’idéalisme alors en vogue dans le cinéma japonais. La rencontre entre l’institutrice et le vendeur de pigeons semble au début pleine de bons sentiments, de naïveté. Et l’institutrice croit rendre service au jeune garçon en lui apportant son soutien moral comme sa compassion. Mais progressivement l’abîme les séparant va crever l’écran. Car si elle compatit pour lui elle ne le comprend pas pour autant. Ce qui les sépare : compassion pour la misère et morale conventionnelle d’un coté, la survie comme seule morale de l’autre. Et d’objet de rapprochement le pigeon va progressivement devenir objet de discorde. Le tout débouchant sur une fin de film plus rythmée, multipliant les grands angles malaisants et une séquence finale scellant l’impossibilité de réconciliation entre classes sociales favorisées et classes sociales défavorisées. Et elle donne au titre du film toute son ironie. Seule partie un peu audacieuse formellement du film, elle porte des promesses de grandeur vite tenues par Oshima.
Pigeonnés
Premier long-métrage d'Oshima, tiraillé entre son envie d'expérimenter et son devoir de se soumettre au schéma d'exécution de la Shochiku. Son film ne dépasse guère l'heure de film pour pouvoir être projeté en double-programme au cinéma.
A la base, le film était pensé – par ses producteurs – comme un mélodrame familial; l'histoire d'un jeune homme tentant de survivre en marge de l'explosion économique japonaise en pleine reconstruction. Oshima en fait une description désabusée. Il accentue les différences de classes, se moque de l'apparent apitoiement d'une certaine catégorisation envers des gens débrouillards et désincarne ses personnages. Il multiplie les cadres moyens ou larges pour accentuer la distanciation entre el spectateur et ses personnages et impose aux acteurs de donner une interprétation aussi dénuée de sentiments que possible. Ce procédé sera porté à son paroxysme dès son prochain, "Contes cruels de la jeunesse", qui va déshumaniser ses personnages et les faire mentir sur les véritables sentiments qui pourraient bouillir derrière leurs façades immobiles.
Il ne s'agit que d'un premier essai et Oshima n'arrive à toucher au sublime qu'en fin de métrage, proposant une série de plans décadrés et enfonçant le clou d'une morale douloureuse.
Rien que pour ces cinq dernières minutes embryonnaires d'un avant-gardiste en devenir, le film vaut largement le détour!
Attention, CARLOTTA, à ne pas mettre des sous-titres blancs sur un film en Noir & BLANC!!! Certains passages sont totalement illisibles.
très bon film! 
C'est un des premiers films de Oshima qui montre bien comment il est doué et original!
Ce qui me permet d'apprécier le film est qu'il ne vieillit pas du tout avec le temps...que ce soit au niveau des images ou du contenu, même si l'expression "noir et blanc" est susceptible de nous créer une trace de temps.