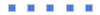

| Xavier Chanoine | 3.5 | Un mélodrame de bonne tenue et visuellement splendide |
| Ordell Robbie | 3.25 | Encore écrasé par ses influences occidentales mais honorable. |
| Ghost Dog | 3 | La tentation de l’argent facile |
Bon film que cet Elégie de Naniwa sorti à une époque où Mizoguchi se cherchait toujours encore un peu, malgré un passé déjà particulièrement riche. Pourtant, si l'on est encore loin de ses meilleures oeuvres, évoquons même "chefs d'oeuvres" des années 50, ce film relativement engagé envers la gente féminine témoigne d'une superbe solidité de fond et de forme. Le scénario, critique acerbe et réaliste du machisme d'époque parfois très surligné par Mizoguchi évoque déjà quelques lignes de ses portraits de femmes, nobles ou dangereusement noirs, où ces dernières n'ont pas le droite de l'ouvrir ni d'omettre un son mal placé. Et lorsqu'elles servent le thé, il est anormal qu'elles aient la moindre saleté sur les mains et se doivent d'obéir au doigt et à l'oeil de ces messieurs. Si le personnage de Ayako est clairement l’un des éléments centraux du film, il serait navrant d’omettre qu’elle porte sur ses frêles épaules la condition d’une majorité de femmes issues de milieux sociaux différents. De part ses risques pris pour tenter de sauver sa famille du naufrage financier, son père étant un parfait incompétent, et le coup de massue qu’elle prend en retour, Mizoguchi aura aligné sur plus d’une heure ce qu’il entreprendra par la suite : les thèmes forts comme la résignation féminine et l’ego anormalement démesuré de la gente masculine, la force de ces êtres forcés à contrôler leur destin, le contexte économique d’avant guerre et encore davantage, résumer l’œuvre de Mizoguchi en quelques lignes relèverait de la bêtise. Si cet Elégie de Naniwa peut souffrir d’un manque de profondeur parce que sa narration souffre d’une durée l’empêchant de pleinement rentrer dans les détails, il conserve néanmoins de superbes qualités indéniables : l’interprétation oscillant entre théâtrale et réalisme pur, sa mise en scène d’une grande justesse de présentation et de beauté picturale (quelques plans figurants parmi les plus beaux jamais vus chez le cinéaste), influences ou pas, l’ensemble est un régal pour les mirettes avec notamment un jeu sur les flous de toute beauté. Particulièrement accessible mais ne représentant pas grandement l’œuvre terminale du cinéaste, L’Elégie de Naniwa est à découvrir.
 L’élégie de Naniwa, que l’on pourrait remplacer par la Symphonie d’Osaka (Naniwa étant l’ancien nom de cette ville), est le 1er vrai film parlant de Mizoguchi, lui qui a réalisé entre 1922 et 1936 une quarantaine de films muets dont seulement 3 ou 4 ont subsisté. Un film très court, puisqu’il ne dure que 68 minutes, et qui marque la 1ère collaboration avec celui qui sera par la suite son scénariste attitré, Yoda Yoshikata. Un film déjà influencé par l’Occident, puisque transparaissent dans de nombreux plans, si l’on en croit Charles Tesson, des références explicites à des cinéastes comme Sternberg ou Lubitsch, que Mizoguchi admire beaucoup.
L’élégie de Naniwa, que l’on pourrait remplacer par la Symphonie d’Osaka (Naniwa étant l’ancien nom de cette ville), est le 1er vrai film parlant de Mizoguchi, lui qui a réalisé entre 1922 et 1936 une quarantaine de films muets dont seulement 3 ou 4 ont subsisté. Un film très court, puisqu’il ne dure que 68 minutes, et qui marque la 1ère collaboration avec celui qui sera par la suite son scénariste attitré, Yoda Yoshikata. Un film déjà influencé par l’Occident, puisque transparaissent dans de nombreux plans, si l’on en croit Charles Tesson, des références explicites à des cinéastes comme Sternberg ou Lubitsch, que Mizoguchi admire beaucoup.
L’intrigue n’est pas des plus originales : une jeune standardiste de condition modeste se laisse attirer par la tentation d’une vie facile en devenant la maîtresse de son patron, malgré son amour pour un de ses collègues de bureau, provoquant quiproquos et rebondissements comme au théâtre. Une manière pour Mizoguchi, déjà, de décrire le destin d’une femme qui tente de trouver sa place dans une société dominée par les rapports de force et par l’argent. Dans ce film, les hommes n’ont déjà pas le beau rôle. Le patron est totalement pathétique, se donnant de grands airs autoritaires tout en esquivant de manière ridicule les conflits, en se cachant par exemple sous sa couette lorsqu’il se fait surprendre par sa femme en galante compagnie. Le père ne vaut pas mieux : il truande sa société puis se cache comme un animal. Et quand le prétendant rivalise de naïveté confondante, le frère réclame de l’argent pour ses études et n’admet pas que sa sœur s’en sorte mieux que lui.
Au milieu de tout ce tumulte, la jeune Ayako apprendra à ses dépens qu’en appartenant à la classe populaire, il était illusoire d’aspirer à la classe aisée en quelques mois. Dès 1936, beaucoup des thèmes chers au grand cinéaste japonais sont donc présents, même s’il se cherche encore du point de vue de la mise en scène : il y a déjà de belles idées (l’utilisation fréquente des ellipses, par exemple), mais aussi des plans rapprochés ou de côté que l’on ne verra plus par la suite. Si le manque de densité narrative aura du mal à captiver totalement le spectateur du XXIème siècle, il serait injuste de ne pas découvrir ce film, tourné 20 ans avant La Rue de la Honte.