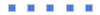


 Naomi Kawase est une cinéaste de la ligne claire, du geste essentiel, comme le trait de pinceau de Shara, comme la caméra de ses films, comme sa personne. Quiconque croise ce petit bout de femme saisit tout de suite d’où viennent ces images d’une grâce infinie, ces acteurs charmants comme des bonbons au caramel, cette nature sensuelle, ce cinéma d’une rare pureté : du Naomi Kawase, c’est Naomi Kawase. Elle se partage entre ses documentaires, ultra intimistes, et ses fictions, ultra universelles, mais les fait avec la même sincérité. Après Shara, maintenant mère et rassurée sur sa capacité à faire du grand cinéma, Naomi Kawase nous offre La forêt de Mogari, film maternel et apaisé, tout aussi sincère que les autres, tout aussi irradiant, mais encore plus simple. Concrètement, c’est une jeune femme et un vieil homme, Nara et sa forêt environnante, de la matière (bois, terre…) et des gestes. Et en même temps, comme dans ses précédents films, Naomi Kawase englobe ce petit univers dans un ensemble universel, un continuum temporel (de la naissance à la mort, la jeunesse à la vieillesse) et un espace infini (de la terre au ciel).
Naomi Kawase est une cinéaste de la ligne claire, du geste essentiel, comme le trait de pinceau de Shara, comme la caméra de ses films, comme sa personne. Quiconque croise ce petit bout de femme saisit tout de suite d’où viennent ces images d’une grâce infinie, ces acteurs charmants comme des bonbons au caramel, cette nature sensuelle, ce cinéma d’une rare pureté : du Naomi Kawase, c’est Naomi Kawase. Elle se partage entre ses documentaires, ultra intimistes, et ses fictions, ultra universelles, mais les fait avec la même sincérité. Après Shara, maintenant mère et rassurée sur sa capacité à faire du grand cinéma, Naomi Kawase nous offre La forêt de Mogari, film maternel et apaisé, tout aussi sincère que les autres, tout aussi irradiant, mais encore plus simple. Concrètement, c’est une jeune femme et un vieil homme, Nara et sa forêt environnante, de la matière (bois, terre…) et des gestes. Et en même temps, comme dans ses précédents films, Naomi Kawase englobe ce petit univers dans un ensemble universel, un continuum temporel (de la naissance à la mort, la jeunesse à la vieillesse) et un espace infini (de la terre au ciel).
Le brouillage des âges est ce que réussit le mieux cette japonaise qui, comme nombre de ses congénères, a entre 20 et 70 ans, selon qu’on parle d’âge physique ou de sagesse de l’esprit, sans qu’on puisse placer le curseur et qu’on ait envie de le faire, d’ailleurs. La forêt de Mogari nous montre ainsi une infirmière qui a trente trois ans, donc l'âge de la sérénité, mais fait la sage mère protectrice de cinquante et la midinette béta de quinze. Elle est amoureuse autant que fossoyeuse d’un vieillard qui veut finir sa vie mais est beau comme un fringant jeune homme, n'a vécu que pour sa femme et renait au moment d'en faire le deuil. Tout le monde de 7 à 77 ans peut tomber amoureux de l’un ou de l’autre, ils sont adorables, notre grand père préféré, notre infirmière idéale. Après une ouverture somptueuse et quelques scènes suffisantes dans une maison de retraite, on passe une bonne heure / du bonheur avec ce couple, dans leurs jeux d’enfants, leurs angoisses d’adultes, leur sérénité de vieillards, tout cela dans une forêt de nos rêves, éclairée par un soleil divin, filmé par une caméra qu’on croirait tenue par un papillon, monté avec des doigts de fée, à l’image comme au son. On en ressort enchanté, gonflé de certitude qu’il existe encore dans ce monde des gens pour faire du grand cinéma.
 D’autant plus que Naomi Kawase ne nous a pas fait baigner dans la facilité. La forêt de Mogari fait écho à concurrent asiatique du festival, Secret Sunshine, et à bien d’autres de la même compétition, autour du thème du deuil. Et qui dit deuil dit douleur. Naomi Kawase tient un discours proche de celui de Lee Chang-dong, mais avec une forme qui n’a rien à voir : ils ne mentent pas, ne font pas croire que c’est facile de se délester du manque et de la culpabilité. Machiko rigole bien avec sa collègue sur une broutille de langage (génial petit rôle de bonne copine avec qui on aimerait se soûler la gueule) mais justement parce qu’elle a besoin de ça, rigoler sur des conneries pour alléger sa vie. Elle s’amuse, elle garde enfouie sa douleur, et pourtant on sait qu’elle est là. Naomi Kawase se plante un peu sur la scène la plus explicative du film, l’entrevue avec le mari de Machiko. Elle est mal amenée, trop courte, trop vite dans le pathos. Pas grave, le principal est ce qu’on en retient et que Naomi Kawase ne remette pas une louche supplémentaire sur le sujet, jusqu’à une scène surprenante à tous points de vue. Machiko va se mettre à hurler lorsque Shigeki traverse un fleuve. Autant il est facile de décrire l’effet que produit cette scène, on chiale comme un gamin, autant il est difficile de savoir qu’est-ce qui emporte le morceau. Le montage exemplaire nous plonge dans un mælström d’émotions, mêlant un sens subtil du son off, un plan large respectueux, une irruption de torrent fantastique, et la voix de Machiko Ono qui vrille le cœur. Un modèle de scène catharsis / exutoire.
D’autant plus que Naomi Kawase ne nous a pas fait baigner dans la facilité. La forêt de Mogari fait écho à concurrent asiatique du festival, Secret Sunshine, et à bien d’autres de la même compétition, autour du thème du deuil. Et qui dit deuil dit douleur. Naomi Kawase tient un discours proche de celui de Lee Chang-dong, mais avec une forme qui n’a rien à voir : ils ne mentent pas, ne font pas croire que c’est facile de se délester du manque et de la culpabilité. Machiko rigole bien avec sa collègue sur une broutille de langage (génial petit rôle de bonne copine avec qui on aimerait se soûler la gueule) mais justement parce qu’elle a besoin de ça, rigoler sur des conneries pour alléger sa vie. Elle s’amuse, elle garde enfouie sa douleur, et pourtant on sait qu’elle est là. Naomi Kawase se plante un peu sur la scène la plus explicative du film, l’entrevue avec le mari de Machiko. Elle est mal amenée, trop courte, trop vite dans le pathos. Pas grave, le principal est ce qu’on en retient et que Naomi Kawase ne remette pas une louche supplémentaire sur le sujet, jusqu’à une scène surprenante à tous points de vue. Machiko va se mettre à hurler lorsque Shigeki traverse un fleuve. Autant il est facile de décrire l’effet que produit cette scène, on chiale comme un gamin, autant il est difficile de savoir qu’est-ce qui emporte le morceau. Le montage exemplaire nous plonge dans un mælström d’émotions, mêlant un sens subtil du son off, un plan large respectueux, une irruption de torrent fantastique, et la voix de Machiko Ono qui vrille le cœur. Un modèle de scène catharsis / exutoire.
Une autre scène restera dans les annales, celle au coin du feu où Machiko et Shigeki se réconfortent, disons, sans mettre de gants. N’était-ce pas la scène la plus hot du festival 2007 ? N’est-ce pas un fantasme absolu d’infirmière idéale ? Et à la fois, une merveille de sensibilité, jouée sans aucune afféterie, hop j’enlève le soutif, dans une lumière, là encore, de rêve. Il y a même de grandes scènes d’action. Non, on rigole, la voiture se plante juste une roue dans le fossé, Shigeki se vautre dans la boue, une pastèque explose, un hélicoptère les cherche. C’est que pour eux ce fut vraiment l’aventure, le film en magnifie chaque petit instant et du coup nous les fait partager intimement.
 Dans les dernières minutes, quand Shigeki dit qu’il dormirait bien là dans la terre, on pense «oh oui, je me ferais bien aussi une sieste sur de la terre fraîche», pas parce qu'on veut dormir mais parce que l'idée de cette sensation nous fait tellement envie, comme presque tout le long du film, on se sent bien, au sens le plus simple du mot, avec Shigeki, Machiko et Naomi. Le film nous mène par la main, une main comme celle de la femme que vous aimez. Il est parfois au bord de la naïveté, mais se tenir doucement par la main, c’est toujours limite gnan gnan, aussi, sauf que le monde entier adore le faire, «je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais», etc.... Confiante et sereine, Naomi nous mène juste un poil trop loin avec un des derniers plans séquences en caméra portée. Certes, il est admirable parce c’est un plan séquence en caméra portée, mais il lasse à faire trop d’allers et retours entre Machiko, Shigeki, les arbres, le ciel. Il cherche son sens, sa raison de durer, alors qu’à plusieurs reprises on se dit que l’arrêter juste là, par exemple au passage de l’hélicoptère ou sur cet arbre qui barre l’écran, ça aurait été parfait. Mais bon, on serait ravi de trouver un tel plan dans tellement d’autres films. Naomi Kawase joue de façon incontestable dans la catégorie Grand Prix à Cannes. Il faut vraiment être monté sur ressorts, cramé en fin de festival, pour trouver qu’un tel film puisse être «ennuyeux» comme on l’a forcément entendu s’agissant d’un film asiatique. Des fois aussi, votre amoureuse elle vous gonfle un chouïa, mais il faut comparer le fait de s’ennuyer une minute avec elle et cinq avec une pétasse.
Dans les dernières minutes, quand Shigeki dit qu’il dormirait bien là dans la terre, on pense «oh oui, je me ferais bien aussi une sieste sur de la terre fraîche», pas parce qu'on veut dormir mais parce que l'idée de cette sensation nous fait tellement envie, comme presque tout le long du film, on se sent bien, au sens le plus simple du mot, avec Shigeki, Machiko et Naomi. Le film nous mène par la main, une main comme celle de la femme que vous aimez. Il est parfois au bord de la naïveté, mais se tenir doucement par la main, c’est toujours limite gnan gnan, aussi, sauf que le monde entier adore le faire, «je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais», etc.... Confiante et sereine, Naomi nous mène juste un poil trop loin avec un des derniers plans séquences en caméra portée. Certes, il est admirable parce c’est un plan séquence en caméra portée, mais il lasse à faire trop d’allers et retours entre Machiko, Shigeki, les arbres, le ciel. Il cherche son sens, sa raison de durer, alors qu’à plusieurs reprises on se dit que l’arrêter juste là, par exemple au passage de l’hélicoptère ou sur cet arbre qui barre l’écran, ça aurait été parfait. Mais bon, on serait ravi de trouver un tel plan dans tellement d’autres films. Naomi Kawase joue de façon incontestable dans la catégorie Grand Prix à Cannes. Il faut vraiment être monté sur ressorts, cramé en fin de festival, pour trouver qu’un tel film puisse être «ennuyeux» comme on l’a forcément entendu s’agissant d’un film asiatique. Des fois aussi, votre amoureuse elle vous gonfle un chouïa, mais il faut comparer le fait de s’ennuyer une minute avec elle et cinq avec une pétasse.

 La Forêt de Mogari intervient à un moment où la filmographie de la cinéaste a déjà atteint de réels niveaux de qualité difficilement surpassables, même si tout cinéaste un tant soit peu talentueux est capable de sans cesse dépasser les limites de son oeuvre globale. Après s'être tâté à son premier long métrage voilà dix ans, Suzaku, et son second Shara, sans compter ses divers moyens métrages autobiographiques et documentaires essentiellement axés sur des personnages proches de la mort, la cinéaste évoque une nouvelle fois le deuil avec son dernier film en date. Si les racines de La Forêt de Mogari ne sont pas diamétralement opposées à celles de ses précédents longs-métrages, on y décerne toutefois plusieurs grandes différences, notamment dans l'approche inédite du deuil : si dans Suzaku le deuil était particulièrement difficile (mêlé qui plus est à un début d'histoire d'amour entre deux cousins), tout comme pour Shara (opposant aussi le deuil à la naissance), La Forêt de Mogari repose sur des bases plus éloignées même si la finalité reste la même : il faut faire l'impasse sur le passé et savoir évoluer quoiqu'il arrive, en se raccrochant à des symboles, des objets, ou même réaliser un véritable parcours du combattant en direction de la tombe de la personne décédée. C'est le cas ici, et là où les deux précédents longs-métrages de Kawase restaient dans un périmètre tout à fait réduit (une maison, un jardin, une place), les deux personnes endeuillées vont ici parcourir toute une forêt, bravant les difficultés avec succès mais non sans crainte.
La Forêt de Mogari intervient à un moment où la filmographie de la cinéaste a déjà atteint de réels niveaux de qualité difficilement surpassables, même si tout cinéaste un tant soit peu talentueux est capable de sans cesse dépasser les limites de son oeuvre globale. Après s'être tâté à son premier long métrage voilà dix ans, Suzaku, et son second Shara, sans compter ses divers moyens métrages autobiographiques et documentaires essentiellement axés sur des personnages proches de la mort, la cinéaste évoque une nouvelle fois le deuil avec son dernier film en date. Si les racines de La Forêt de Mogari ne sont pas diamétralement opposées à celles de ses précédents longs-métrages, on y décerne toutefois plusieurs grandes différences, notamment dans l'approche inédite du deuil : si dans Suzaku le deuil était particulièrement difficile (mêlé qui plus est à un début d'histoire d'amour entre deux cousins), tout comme pour Shara (opposant aussi le deuil à la naissance), La Forêt de Mogari repose sur des bases plus éloignées même si la finalité reste la même : il faut faire l'impasse sur le passé et savoir évoluer quoiqu'il arrive, en se raccrochant à des symboles, des objets, ou même réaliser un véritable parcours du combattant en direction de la tombe de la personne décédée. C'est le cas ici, et là où les deux précédents longs-métrages de Kawase restaient dans un périmètre tout à fait réduit (une maison, un jardin, une place), les deux personnes endeuillées vont ici parcourir toute une forêt, bravant les difficultés avec succès mais non sans crainte.
Cette crainte repose sur les frêles épaules de Machiko, jeune mère ayant perdu son fils et n'arrivant pas à faire le deuil à cause des remords de son mari la jugeant toujours coupable. Cette dernière, devenue assistance médicale pour personnes âgées va se retrouver confrontée au désir de son hôte, Shigeki, aveuglé à l'idée de retrouver la tombe de sa femme décédée voilà 33 ans. Pourquoi une telle idée? Un moine Bouddhiste lui confia qu'au bout du trente-troisième anniversaire célébrant la mort, l'esprit du défunt rejoint Bouddha et quitte la Terre pour de bon. Le plus étonnant est de voir qu'avec un matériau de base d'une telle simplicité, la cinéaste arrive à insuffler un véritable esprit de bien-être, confirmant ainsi l'importance de la nature pour l'Homme : labyrinthique, inaccessible, dense, rien qui n'empêche pourtant Machiko et Shigeki d'évoluer comme des crèves la faim, et aux deux interprètes de faire preuve d'une grâce et d'un naturel peu communs dans une industrie du cinéma japonais plutôt morose et en réelle perte d'identité : Ono Machiko, débutante il y a dix ans, laisse échapper la moindre de ses émotions en partie lors d'une séquence exceptionnelle où elle refuse que Shigeki traverse un cours d'eau. Elle tombera en larme, perturbée, plus tout à fait elle-même, comme un mauvais souvenir (la perte de son enfant, noyé?) qui ressurgit naturellement, et au vieillard de venir la consoler par ses paroles pleines de sagesse. Cette complicité au départ inexistante (Shigeki ira jusqu'à la violenter pour protéger un sac à dos) deviendra leur principale force, s'entraidant le soir après un déluge de pluie, près d'un feux, ou lorsqu'il faut grimper une colline boueuse. 
Au-delà même de cet élan humaniste, une première pour un long métrage signé Kawase, La Forêt de Mogari représente en quelque sorte l'accomplissement formel de son auteur, bien aidée par une quantité de symboliques certes parfois lourdes (la boîte à musique, les mémoires...) mais souvent d'une grande pureté (le gigantesque arbre mort, le feuillage, la pluie...) toutes plus ou moins en rapport direct avec la nature : l'omniprésence de plans contemplatifs en plongée vers les feuillages, le ciel, les différents plans larges mettant l'accent sur le déchaînement de la forêt, sur les herbes portées par le vent (dignes d'un Miyazaki Hayao). On note une fois n'est pas coutume les clins d'oeil de Kawase à son propre cinéma passé, comme cette petite clochette que l'on entend, provenant d'un porte-bonheur, ces fameux gros plans guère anodins sur de longues fleurs, ces baraques installées sur les collines, ce linge étendu au soleil, ces mélodies minimalistes au piano, goût prononcé pour le plan-séquence, le spectateur attentif au cinéma de cette cinéaste ne sera pas en terrain inconnu, bien au contraire. Il pourra en revanche être déçu par le manque de véritable poésie, mais ce léger manque est compensé en contrepartie par un humanisme plus exacerbé, davantage mis en valeur par la complicité quasi charnelle de Machiko et Shigeki. Enfin ne faisons pas la fine bouche, La Forêt de Mogari n'est pas le grand film espéré, mais simplement une oeuvre puisant ses forces dans son naturel et la nature qu'elle met en scène, avec le regard pur d'une cinéaste qui donna ses lettres de noblesse au genre "nature".


