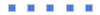



Après le superbe Une Auberge à Tokyo, cet Ozu vient confirmer que le cinéaste était déjà néoréaliste avant l'heure dans sa période muette. Mais film à l'avant-garde de son art ne signifie pas forcément film parfait: un peu comme le (superbe malgré tout) Faust de Murnau, le plaisir est un petit peu gaché par des cadrages qui sont loin d'avoir la précision qu'ils gagneront par la suite chez le cinéaste, chose dont on n'aurait pas envie de se formaliser si justement comme dans le film de Murnau cet aspect-là n'aboutissait pas à des plans coupant la moitié de la tete de certains personnages. Mais ce point de reproche est ici compensé très largement par la force cinématographique de l'oeuvre. D'abord, c'est un film au rythme rapide à une échelle ozuienne, un bel instantané d'époque qui respire une plaisante naiveté. Avec ses moments comiques, son coté instantané de pitreries d'école, le film brille par sa spontanéité et sa fraicheur intacte qui en font un cousin lointain des premiers classiques de la Nouvelle Vague. Et aussi de beaux passages comme la très drole projection du film et les moments où le père se retrouve placé par ses enfants devant ses contradictions, à savoir faire pression sur eux pour qu'ils réussissent scolairement tandis qu'il ne se donnerait pas assez de mal pour réussir professionnellement de son coté. Le film est rempli de ces moments qui lui donnent une certaine gravité derrière sa légèreté de surface vu qu'il est aussi le récit du moment cruel où les enfants prennent conscience des questions matérielles et des différences de classes sociales, d'une forme de maturité acquise très tot qui est aussi une perte de l'innocence, qui fait qu'on est assez triste pour eux tout en se disant qu'ils se voient nantis très tot d'un regard lucide sur ce qui les entoure.
Concernant la direction d'acteurs des enfants, ce film fait penser à ce que disait HHH -grand admirateur d'Ozu- lors de la rétrospective qui lui fut consacrée à la Cinémathèque, à savoir qu'il appréciait de diriger des enfants parce qu'ils lui offraient bien plus vite la bonne prise. La spontanéité du jeu des gamins que l'on voit ici à l'écran, le naturel confondant de leur jeu donnent envie de souscrire à ces propos.
Même si Gosses de Tokyo reste une oeuvre charnière du pan cinématographique nippon, on ne peut nier la comparaison avec son remake, le génial Bonjour, dont il s'est inspiré des grandes lignes qui faisaient justement la force de Gosses de Tokyo. Il n'y a pas la grâce et l'humour incroyable de l'opus de 59 (annonçant aussi la fin de l'âge d'or nippon) mais il reste suffisamment concluant pour faire parti des meilleurs Ozu de sa période muette. Il est aussi l'un des plus drôles, mettant en avant la thématique de la société à savoir la place qu'ont les salarymen, leur importance au sein même de cette société, la jeunesse (celle qui prendra le relais lorsque le Japon subira un vrai bouleversement économique et social) et l'insouciance, même aussi les tracas de la vie quotidienne, celle qui fait que l'on avance à reculons, à l'image de ces deux bambins timides et lâches au premier abord mais finalement courageux voir même "violents" au fur et à mesure qu'ils prennent confiance en eux.

Ozu démontre alors que les mômes ont aussi leur mot à dire dans la société et qu'il est souvent bon d'encourager les plus vieux pour faire avancer les choses. C'est ainsi que les deux enfants se réconcilieront avec leur père après une bonne gueulante et une grève de la faim (remplacée par le silence dans la version de 1959). Mais Gosses de Tokyo est plus grave que son homologue de 59 dans la mesure où il traite de la condition même de l'homme, du salaryman de base. Les mômes engagent une grève de la faim pour faire prendre conscience à leur père qu'il n'est pas un minable et qu'il peut être tout aussi important que des personnes plus riches (remise en question de l'importance matérielle), alors que dans Bonjour ces derniers entament une grève de la parole tout simplement pour avoir une télévision (remise en cause de l'importance de l'image et de l'information au sein d'un foyer), d'où cet aspect moins tranchant que Gosses de Tokyo, gros constraste avec la légèreté et la gaieté des grands Ozu de la fin des années 50, début 60.
Ozu fait partie des 4 ou 5 réalisateurs qui ont marqué le cinéma de leur empreinte pour des siècles. Il a tourné beaucoup de films muets, et Gosses de Tokyo en est un. Mais quand je dis muet, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus muet : pas un mot ni même une mélodie ne vient relever les images qui défilent sous nos yeux (vivement une " musicalisation " de ce film !) . A une époque où l'on est gavé de son Dolby Stéréo Surround je sais pas quoi, voir un film sans le moindre bruit est très perturbant ; il s'agit quand même de comprendre l'histoire à la seule force des images, ce qui est loin d'être évident, ce qui fait aussi qu'on perd le fil à plusieurs reprises…
Mais bon, on arrive globalement à comprendre la trame : à la manière de Tom Sawyer ou des 400 Coups, on a affaire une bande de gamins chahuteurs et adeptes de l'école buissonnière, qui se chamaillent et se bagarrent à longueur de temps. Difficile de ne pas penser à un retour sur soi de la part d'Ozu, un retour sur son enfance, qu'il considère maintenant évidemment avec du recul, de manière plus détachée. La dernière partie de Gosses de Tokyo est d'ailleurs plus engagée, les 2 enfants reprochant avec virulence à leur père de n'être qu'employé, et de ne pas se donner assez de mal pour devenir dirigeant. Reproche difficile à gober pour le père, qui va tant bien que mal leur faire comprendre que c'est aussi ça la vie, réussir à admettre que l'on n'est pas forcément le meilleur.
Il n'empêche que ce film ne me laissera pas un souvenir impérissable, tant par le fond que par la forme. J'attends de voir le reste de la filmo du grand Ozu…