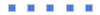

Avis Express
On ne va pas rajouter des couches par rapport à ce qui a été -très bien- dit dans ces colonnes, Gonin est de ces polars marquants parce que son cinéaste en a fait ce qu'il voulait sans recopier à la lettre près les codes du polar traditionnel (pire encore, les codes du yakuza eiga). Grand film sur le rapport humain de loser à loser, film compte-à-rebours par excellence où la moindre séquence calme en apparence cache un revirement de situation où plane l'ombre de la faucheuse Kitanienne, justicier de l'au-delà par excellence qu'on ne voit pourtant qu'en deuxième partie de film. Essentiellement masculin (si l'on omet la prostituée thaïlandaise et la famille de Hizu) et vrai film d'homme nihiliste, on retrouve le gangster en jogging cher au cinéma de Kitano mais dans son versant punk, Ishii gratifiant son métrage d'une mise en scène virtuose à la violence sèche. Du Kitano-like en somme en mode agité, alors que ce dernier usait et usera du plan fixe pour se focaliser sur l'émotion. Le côté parfois théâtralisé et grand guignolesque du personnage de Kitano en fin de métrage, dans la séquence suivant l'ultime fusillade sous la pluie, contraste avec l'aspect parfois éprouvant et étrangement glauque du métrage: le passage du viol de la prostituée et du molestage du malade dans un parking est un bon exemple parce que la distance de la caméra crée le malaise, tout comme celle de l'ex-salaryman loser rentrant chez lui et qui retrouve sa famille massacrée sans s'en rendre compte, le thème de La Lettre à Elise joué au piano et le bruit des mouches nous donneraient presque 15 ans dans les pattes d'un coup tant le climat d'épouvante est pesant. Remarquable travail d'ambiance pour autant de scènes marquantes toutes à peu près énumérées par Ordell plus bas, quitte à rajouter la séquence du baiser d'un dernier souffle. Avec Gonin, Ishii aura donné un superbe coup de balais au yakuza-eiga et signe par la même occasion un polar de grande, très grande envergure tout court.
 Gonin est atypique dans la filmographie d'un réalisateur surtout concerné par la condition de la femme. Il s'agit en effet d'un polar où les personnages féminins sont inexistants (les yakuzas y sont montrés comme un monde clos et strict où la proximité exacerbe les penchants homosexuels, anticipant en cela les samourais queer de Tabou, film où jouera encore Kitano), au scénario mille fois vu (en gros : des yakuzas font un casse et l'escroqué lance des tueurs sanguinaires à leurs trousses, bref que du usé et archirebattu). Mais le déjà vu du scénario est difficilement critiquable vu que le film noir moderne trouve son originalité non dans son récit mais dans le traitement formel et/ou narratif de ce dernier (un Reservoir Dogs vaut par le découpage narratif d'un récit de casse qui rate à cause d'un indic qui existe depuis la naissance du caper movie -le film de casse-, un the Mission tire son originalité de la réalisation de ses gunfights et non de son scénario).
Gonin est atypique dans la filmographie d'un réalisateur surtout concerné par la condition de la femme. Il s'agit en effet d'un polar où les personnages féminins sont inexistants (les yakuzas y sont montrés comme un monde clos et strict où la proximité exacerbe les penchants homosexuels, anticipant en cela les samourais queer de Tabou, film où jouera encore Kitano), au scénario mille fois vu (en gros : des yakuzas font un casse et l'escroqué lance des tueurs sanguinaires à leurs trousses, bref que du usé et archirebattu). Mais le déjà vu du scénario est difficilement critiquable vu que le film noir moderne trouve son originalité non dans son récit mais dans le traitement formel et/ou narratif de ce dernier (un Reservoir Dogs vaut par le découpage narratif d'un récit de casse qui rate à cause d'un indic qui existe depuis la naissance du caper movie -le film de casse-, un the Mission tire son originalité de la réalisation de ses gunfights et non de son scénario).
 Et dans Gonin tout est dans un travail formel et sonore qui sert le nihilisme foncier du film (les yakuzas y sont montrés comme des machines à tuer prisonnières de la barbarie de leurs codes d'honneur, idée qui s'incarne idéalement en un Kitano jouant à la perfection un véritable Terminator qui laissera éclater sa lassitude à la fin du film; les auteurs du casse ne pourront pas échapper au destin tragique qui s'ouvre sous leurs pieds): le début s'ouvre en montrant un yakuza revoyant en accéléré ses souffrances, enchaine sur des plans aériens montrant Tokyo comme ville géante et ville prison à la fois puis la caméra s'introduit via un trou dans un hangar où les yakuzas s'entrainent au base ball comme des machines. La dilatation des plans séquences des scènes intimistes crée l'impression d'un piège se refermant lentement sur les personnages.
Et dans Gonin tout est dans un travail formel et sonore qui sert le nihilisme foncier du film (les yakuzas y sont montrés comme des machines à tuer prisonnières de la barbarie de leurs codes d'honneur, idée qui s'incarne idéalement en un Kitano jouant à la perfection un véritable Terminator qui laissera éclater sa lassitude à la fin du film; les auteurs du casse ne pourront pas échapper au destin tragique qui s'ouvre sous leurs pieds): le début s'ouvre en montrant un yakuza revoyant en accéléré ses souffrances, enchaine sur des plans aériens montrant Tokyo comme ville géante et ville prison à la fois puis la caméra s'introduit via un trou dans un hangar où les yakuzas s'entrainent au base ball comme des machines. La dilatation des plans séquences des scènes intimistes crée l'impression d'un piège se refermant lentement sur les personnages.
La violence est filmée de façon distante et rapide (abondance de zooms brefs et montage haché dans les scènes de flinguage) comme si elle était trop horrible pour etre supportable à la vue (flagrant dans la scène du viol de la prostituée thailandaise mais aussi dans les nombreux flinguages théatralisés du film). La photographie crée des ambiances nocturnes d'un bleu eighties bienvenu. La répétition des gouttes d'eau nous fait ressentir le malaise des personnages, le dégout de la monotonie de leur "travail". La musique alternant synthétiseurs qui construisent une atmosphère lourde et guitares d'esprit new wave en rajoute dans l'idée de proximité de la mort présente tout le long du film. Les penchants clinquants d'Ishii sont ici à peu près canalisés dans ce qui est de loin son film le plus rigoureux. Petite fausse note: la chanson sirupeuse utilisée dans la séquence d'attente dans la voiture à la fin conviendrait tout à fait à n'importe quel hero movie made in hk mais est totalement déplacée ici vu que c'est plutot la gravité qui domine. En outre, le film contient également des séquences assez fortes pour imprimer la rétine: le viol de la prostituée et le passage à tabac de son copain filmés à distance, l'arrivée d'un des yakuzas chez lui ne se doutant pas du massacre de sa famille qui a été perpétré et qui est suggéré par des éclats de verre, la scène du restaurant où la tension est palpable, le flinguage pluvieux et le final dans le bus qui rend le recueillement du survivant impossible.
Gonin est de loin le meilleur Ishii qu'on ait vu. Sa forme sans scories trop pénalisantes, son montage moins bancal et son scénario plus écrit que ceux d'autres films du cinéaste associés au petit plus Kitano en font une série B de très bonne facture.
 Je dois dire que le film de Ishii m’a beaucoup étonné ; cela faisait en effet longtemps que je n’avais pas visionné une œuvre aussi noire et aussi désespérée, montrant l’univers des yakusa de manière tellement abrupte et réaliste que cela provoque des frissons dans le dos. De l’ambiance, presque totalement nocturne, aux décors urbains peu rassurants (garages, rues sombres), Gonin est d’abord un film de sensations, induites dès l’entame par une séquence de rêve troublante (qui aurait mérité un développement) puis par un survol de Tokyo en hélico qui laisse présager le pire. La violence règne froidement dans ce milieu d’hommes, les meurtres se succèdent sans états d’âme, et l’atmosphère qui en découle est si perturbante pour les différents personnages que, élément le plus intéressant du film, une déviance des identités sexuelles s’opère et que l’homosexualité, tendre ou bestiale, devient presque une norme (l’hétérosexualité est par exemple interdite par les yakusa en ce qui concerne Jimmy et sa copine thai, et seul le viol peut la justifier !).
Je dois dire que le film de Ishii m’a beaucoup étonné ; cela faisait en effet longtemps que je n’avais pas visionné une œuvre aussi noire et aussi désespérée, montrant l’univers des yakusa de manière tellement abrupte et réaliste que cela provoque des frissons dans le dos. De l’ambiance, presque totalement nocturne, aux décors urbains peu rassurants (garages, rues sombres), Gonin est d’abord un film de sensations, induites dès l’entame par une séquence de rêve troublante (qui aurait mérité un développement) puis par un survol de Tokyo en hélico qui laisse présager le pire. La violence règne froidement dans ce milieu d’hommes, les meurtres se succèdent sans états d’âme, et l’atmosphère qui en découle est si perturbante pour les différents personnages que, élément le plus intéressant du film, une déviance des identités sexuelles s’opère et que l’homosexualité, tendre ou bestiale, devient presque une norme (l’hétérosexualité est par exemple interdite par les yakusa en ce qui concerne Jimmy et sa copine thai, et seul le viol peut la justifier !).
 Gonin a cependant beau posséder des qualités indéniables, il ne fait que reprendre sans grand enthousiasme un scénario des plus classiques : un groupe se structure autour d’un leader pour tenter un gros coup (ici le cambriolage d’un gang de yakusa) avant de se déstructurer sous les coups de boutoirs de la vengeance. Le code d’honneur des yakusa les oblige en effet à éliminer jusqu’au dernier de la manière la plus bornée les enfoirés qui ont osé s’en prendre à eux. Dans un contexte différent, on pense un peu à The Mission, réalisé 4 ans plus tard. D'autre part, les 5 personnages principaux ne sont pas du tout attachants et leur destin ne nous passionne pas plus que ça. La conclusion est attendue et peut paraître longue à arriver pour certains ; et puis, la qualité moyenne du VCD n’arrange pas les choses. Le bilan est donc nuancé, mais le film est à voir puisque Ishii sort peu à peu de l’ombre dans nos contrées.
Gonin a cependant beau posséder des qualités indéniables, il ne fait que reprendre sans grand enthousiasme un scénario des plus classiques : un groupe se structure autour d’un leader pour tenter un gros coup (ici le cambriolage d’un gang de yakusa) avant de se déstructurer sous les coups de boutoirs de la vengeance. Le code d’honneur des yakusa les oblige en effet à éliminer jusqu’au dernier de la manière la plus bornée les enfoirés qui ont osé s’en prendre à eux. Dans un contexte différent, on pense un peu à The Mission, réalisé 4 ans plus tard. D'autre part, les 5 personnages principaux ne sont pas du tout attachants et leur destin ne nous passionne pas plus que ça. La conclusion est attendue et peut paraître longue à arriver pour certains ; et puis, la qualité moyenne du VCD n’arrange pas les choses. Le bilan est donc nuancé, mais le film est à voir puisque Ishii sort peu à peu de l’ombre dans nos contrées.

 Littéralement Gonin signifie « Cinq hommes », les cinq hommes que Takeshi Ishii, avec un plaisir presque sadique, va faire plonger dans une spirale infernale. Nous sommes en 1995 à Tokyo, le propriétaire d'une boîte de nuit sans prétention réunit une équipe de cinq membres (lui y comprit) pour attaquer le quartier général d’un chef Yakusa et s’emparer d’une somme de cent millions de Yen. L’attaque se déroule malheureusement mal et deux tueurs sont lâchés aux trousses des cinq braqueurs.
Littéralement Gonin signifie « Cinq hommes », les cinq hommes que Takeshi Ishii, avec un plaisir presque sadique, va faire plonger dans une spirale infernale. Nous sommes en 1995 à Tokyo, le propriétaire d'une boîte de nuit sans prétention réunit une équipe de cinq membres (lui y comprit) pour attaquer le quartier général d’un chef Yakusa et s’emparer d’une somme de cent millions de Yen. L’attaque se déroule malheureusement mal et deux tueurs sont lâchés aux trousses des cinq braqueurs.
Voyons de plus prés chaque personnage. Tout d’abord Bandai (Kouichi Sato) le propriétaire d’une boîte de nuit, endetté par des Yakusa et l’instigateur du braquage raté perpétué sur ces derniers. Mitsuya (Masahiro Motoki) un jeune homme qui se fait passer pour un homosexuel auprès de personnes fortunées pour ensuite leurs faire du chantage. Ogiwara (Naoto Takenaka) un salaryman licencié de sa boîte après vingt ans de travail. Hizu (Jinpachi Nezu) un ex-flic reconvertis en gardien d’un petit Pub à hôtesses. Et enfin Jimmy (Kippei Shiina) un banal fonctionnaire qui entretient la machinerie d’un terrain de Base-ball automatisé.
 Comme on peut le constater, ces cinq hommes sont tous des marginaux, des iconoclastes perdus dans un Japon en crise que Takeshi Ishii va manipuler tout au long du récit comme un marionnettiste avec ses pantins. Sombre histoire d’argent dont la noirceur a rarement vu son égal, « Gonin » est un film sur l’impasse et la décomposition totale de ses personnages. Pris malgré eux dans un engrenage dont la fin sera fatale, le film s’attardera sur chaque personnage et sur sa mort violente. Une mort représentée par Kyoya (interprété par Takeshi Kitano dans un rôle sur mesure) un tueur à gage mentalement aliéné, le regard perçant et qui cache une incontestable démence (personnage qui fait d’ailleurs échos au rôle de Yakusa qu’il interprétait déjà dans son énigmatique Boiling Point. Celui-ci est secondé par un jeune garçon, son « frère » mais aussi son souffre douleur sur qui il passe sa colère de manière assez singulière.
Comme on peut le constater, ces cinq hommes sont tous des marginaux, des iconoclastes perdus dans un Japon en crise que Takeshi Ishii va manipuler tout au long du récit comme un marionnettiste avec ses pantins. Sombre histoire d’argent dont la noirceur a rarement vu son égal, « Gonin » est un film sur l’impasse et la décomposition totale de ses personnages. Pris malgré eux dans un engrenage dont la fin sera fatale, le film s’attardera sur chaque personnage et sur sa mort violente. Une mort représentée par Kyoya (interprété par Takeshi Kitano dans un rôle sur mesure) un tueur à gage mentalement aliéné, le regard perçant et qui cache une incontestable démence (personnage qui fait d’ailleurs échos au rôle de Yakusa qu’il interprétait déjà dans son énigmatique Boiling Point. Celui-ci est secondé par un jeune garçon, son « frère » mais aussi son souffre douleur sur qui il passe sa colère de manière assez singulière.
 Gonin est un film qui multiplie les scènes violente sur un rythme frénétique, comme cette goutte d’eau qui ne cesse de tomber à intervalle régulier. Les fusillades, passage à tabac et autre viol collectif sont propre au genre (le film de Yakusa) et certaines ressemblance avec l’œuvre de Seijun Suzuki (spécialiste du genre qui fit ses marques durant les années 60) sont notable. La violence se déroule en effet chez Ishii comme chez le grand cinéaste de manière toujours surréaliste, comme si elle prenait lieu dans un cauchemar, un tableau. D’autant plus que les tout premiers plans du film représentent un cauchemar de Bandai qui est une vision décadente de son futur proche imagé par sa rencontre avec l’étrange Mitsuya.
Gonin est un film qui multiplie les scènes violente sur un rythme frénétique, comme cette goutte d’eau qui ne cesse de tomber à intervalle régulier. Les fusillades, passage à tabac et autre viol collectif sont propre au genre (le film de Yakusa) et certaines ressemblance avec l’œuvre de Seijun Suzuki (spécialiste du genre qui fit ses marques durant les années 60) sont notable. La violence se déroule en effet chez Ishii comme chez le grand cinéaste de manière toujours surréaliste, comme si elle prenait lieu dans un cauchemar, un tableau. D’autant plus que les tout premiers plans du film représentent un cauchemar de Bandai qui est une vision décadente de son futur proche imagé par sa rencontre avec l’étrange Mitsuya.
 Mais Gonin, c’est plus qu’un simple film de Yakusa stylisé et violent, c’est aussi et surtout un brillant portrait humain. Ishii prend le temps d’aborder chaque personnage pour souligner sa défaillance et ses faiblesses. Ainsi Ogiwara est un salaryman réduit à mentir à sa famille à propos de sa situation et s’enterrera dans le mensonge qui le mènera à la folie. Après avoir massacré sa femme et sa fille, il continuera à croire en leur existence et vivra dans cette illusion. Jimmy lui, est le seul personnage « mort né », d’une part à cause de son accord aveugle pour le braquage et de sa relation impossible avec une jeune prostitué d’origine thaïlandaise, l’occasion d’aborder furtivement le thème de l’immigration au Japon, thème qu’on revoit avec plus de « maturité » dans les films de Takeshi Miike. Attachant, celui-ci meurt (le premier) dans d’atroce circonstances.
Mais Gonin, c’est plus qu’un simple film de Yakusa stylisé et violent, c’est aussi et surtout un brillant portrait humain. Ishii prend le temps d’aborder chaque personnage pour souligner sa défaillance et ses faiblesses. Ainsi Ogiwara est un salaryman réduit à mentir à sa famille à propos de sa situation et s’enterrera dans le mensonge qui le mènera à la folie. Après avoir massacré sa femme et sa fille, il continuera à croire en leur existence et vivra dans cette illusion. Jimmy lui, est le seul personnage « mort né », d’une part à cause de son accord aveugle pour le braquage et de sa relation impossible avec une jeune prostitué d’origine thaïlandaise, l’occasion d’aborder furtivement le thème de l’immigration au Japon, thème qu’on revoit avec plus de « maturité » dans les films de Takeshi Miike. Attachant, celui-ci meurt (le premier) dans d’atroce circonstances.
 On en vient au trio principal du film Bandai, Mitsuya et Hizu autour desquels la dernière partie du film va s’articuler. Hizu est décrit comme le plus lucide des cinq, celui qui a un passé derrière lui illustré par son ex-femme à qui il promet de revenir vivre comme autrefois. Il lui offre un album de musique avec une chanson qu’il affectionne particulièrement Akai Hana. Cette même musique qu’il écoutera dans une voiture au côté de Mitsuya (splendide scène), avant de mourir peu après criblé de balles dans une dernière fusillade onirique. Enfin le duo Mitsuya / Bandai que Ishii souligne particulièrement dans le dernier quart d’heure. Ce duo cache en vérité une amitié que le réalisateur va dévoiler seulement au moment de la mort de Bandai, lorsque ce dernier embrassera Mitsuya après lui avoir demandé une dernière requête. Mitsuya après la vaine et sanglante tentative d’en finir avec les Yakusa (geste qui tient du désespoir doublé d’un désir de vengeance) optera finalement pour la fuite (tous sont mort sauf lui) et, accompagné d’une boîte contenant les cendres du défunt Bandai, prend un bus qui doit l’emmener à Lida (pour y tenir sa promesse).
On en vient au trio principal du film Bandai, Mitsuya et Hizu autour desquels la dernière partie du film va s’articuler. Hizu est décrit comme le plus lucide des cinq, celui qui a un passé derrière lui illustré par son ex-femme à qui il promet de revenir vivre comme autrefois. Il lui offre un album de musique avec une chanson qu’il affectionne particulièrement Akai Hana. Cette même musique qu’il écoutera dans une voiture au côté de Mitsuya (splendide scène), avant de mourir peu après criblé de balles dans une dernière fusillade onirique. Enfin le duo Mitsuya / Bandai que Ishii souligne particulièrement dans le dernier quart d’heure. Ce duo cache en vérité une amitié que le réalisateur va dévoiler seulement au moment de la mort de Bandai, lorsque ce dernier embrassera Mitsuya après lui avoir demandé une dernière requête. Mitsuya après la vaine et sanglante tentative d’en finir avec les Yakusa (geste qui tient du désespoir doublé d’un désir de vengeance) optera finalement pour la fuite (tous sont mort sauf lui) et, accompagné d’une boîte contenant les cendres du défunt Bandai, prend un bus qui doit l’emmener à Lida (pour y tenir sa promesse).
Les dernières minutes du film sont d’une efficacité rarement atteinte dans un polar japonais : Le tueur Kyoya (aveuglé lui aussi par la vengeance) interrompe la quiétude illusoire de Matsuya stupéfait par l’apparition quasi spectrale de ce dernier. Un échange de tire (filmé au ralentit) s’opère et Kyoya finit par dire « Je suis fatigué» et va s’asseoir au côté d’un Matsuya inerte, le regard fixé vers l’extérieur. Le bus reprend alors sa route.
 Au début du film, Bandai se réveille (par des gouttes d’eau) alors qu’il faisait un cauchemar (le film). A la fin Mitsuya quant à lui «s’endort » (les gouttes d’eau sont remplacées par des gouttes de sang) après avoir vécu ce cauchemar. Fantastique parallèle sur lequel Takeshi Ishii clôt une œuvre unique et fondamental pour le cinéma japonais des années 90.
Au début du film, Bandai se réveille (par des gouttes d’eau) alors qu’il faisait un cauchemar (le film). A la fin Mitsuya quant à lui «s’endort » (les gouttes d’eau sont remplacées par des gouttes de sang) après avoir vécu ce cauchemar. Fantastique parallèle sur lequel Takeshi Ishii clôt une œuvre unique et fondamental pour le cinéma japonais des années 90.
Voici donc Gonin, ce film-culte qui fait assez souvent parler de lui comme le pendant japonais des meilleurs Ringo Lam. Il est en fait assez étonnant que le Japon qui dispose d'un genre local particulier -le film de Yakuzas- n'a depuis Seijun Suzuki pas produit de polar mémorable, tout du moins suffisamment pour transcender les frontières et arriver -au moins- dans de nombreux festivals occidentaux.
En effet, le polar a été récupéré de manière plus ou moins magistrale par les Lam, les Wong, les Tarantino, les Foley, les de Palma, qui ont tous a des degrés divers été shootés au film de Yakuzas. Gonin représente donc un juste retour des choses, avec son scénario maintes fois rabaché, ses références à Pulp Fiction, son imagerie du gangster post-moderne, ...
L'oeuvre en elle-même est particulièrement singulière. Après un début franchement peu passionnant -mais quelle bande de losers !-, le plot est lancé à une vitesse plutôt jouissive. L'oeuvre au noir du début vire à l'ultra-noir : la violence est purement graphique et ne prive pas le spectateur de tout plaisir malsain (chouette !). Le sang gicle et les gunfights fusent. Plus proches d'un Michael Heat Mann que d'un ex-Dieu-du-flingage-en-apesanteur, les fusillades sont statiques, sèches, théatralisées, monstrueusement sanglantes.
A la limite du surnaturel, le film enchaîne les mexican stand-ups, les massacres d'enfants, les passages à tabac, et ce jusqu'à la dernière seconde.
On n'éprouve ainsi aucune sympathie ni pitié pour aucun des protagonistes. Nous n'avons qu'une envie : qu'ils crèvent tous, le peu de charisme dont font preuve les interprètes aidant - excepté Kitano qui compose un rôle sublime de gunfighter maladif. Ainsi, la bizarrerie ambiante, le potentiel lose ultime des """héros""", un Kitano trop peu présent tirent plutôt le film vers le bas. Les moments purement jouissifs sont toutefois au rendez-vous (il faut être amateur !). C'est bon, mais gardez vos cassettes de Suzuki !


