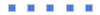

| Ordell Robbie | 2 | Fumage de moquette parsemé de fulgurances mais souvent très mal monté. |
| Xavier Chanoine | 3 | Inégal, mais très souvent à couper le souffle |
| Yann K | 4  |
S'il ne restait qu'un visage |
Bande annonce
Film de la réconciliation entre Aoyama Shinji et ses expérimentations artistiques, où le son et l’image valent mieux que d’interminables lignes de script qui filent des maux de crâne ; Eli, Eli, Lema Sabachthani? et son titre imprononçable renoue également avec le film lunaire, le trip qui ne s’explique pas et qui se vit. Aucune appréhension possible, pas même l’esquisse d’imaginer ce à quoi peut ressembler son dernier film avant un Sad Vacation risqué mais plus sage dans le fond. Depuis quelques temps, un virus s’est propagé dans le monde, obligeant les contaminés à se suicider. Cependant, deux musiciens un peu particuliers sont persuadés que leur musique axée noise peut sauver des vies, dont celle d’Hana, contaminée depuis peu. Affublés de leur masque à oxygène, les musiciens parcourent les régions du Japon, plus à l’aise lorsque amplis et guitares électriques trainent près d’eux : ils expérimentent des sons, des vibes, un remède contre ce fléau assurément. Lorsqu’un vieillard et sa petite fille croisent leur chemin au sein de la maison de Navi, femme d’un certain âge interprétée par une Okada Mariko d’une élégance remarquable, l’objectif d’une telle rencontre est la guérison de la petite.


Le plus clair du temps en apesanteur, Eli, Eli, Lema Sabachthani? exacerbe les sens du spectateur en le mettant à l’épreuve. Jusqu’au bout, Aoyama pousse le spectateur dans ses derniers retranchements en affichant un nombre sidérant de temps morts à la fois emplis d’une grâce absolue, comme l’ensemble de ces plans filmant Miyazaki Aoi à distance suffisante pour ne pas brusquer son visage béni des dieux (qui eux, ne l’ont pas abandonné), ou ceux carrément stone mettant en scène Mizui (impeccable Asano Tadanobu) et son acolyte en pleine séance de démo noise pas tout à fait audible, mais remède à bien des malheureux et expérience sensorielle aussi éprouvante que fascinante. Qu’importe ses errances, elles sont hypnotisantes, qu’importe ses audaces scénaristiques limite autistes, elles donnent au film une texture et une matière façonnables par tout le monde, seules les affinités de chacun feront la différence. La patience également. Personne ici ne pourra remettre en cause les audaces de Aoyama, tranchant dans le vif par des partis pris formels et narratifs en décalage avec le tout-venant nippon. Aoyama l’a sûrement bien compris en castant Miyazaki Aoi, et beaucoup l’ont sûrement oublié, mais la plus belle séquence n’est ni musicale, ni planante, ni purement formelle : c’est une simple rencontre au sein d’un même plan, entre Okada Mariko et Miyazaki Aoi, deux actrices qui ont marqué et qui continent de marquer le cinéma de leur regard, vecteurs de sensations et d’émotions inépuisables.


Aimer ce film, c’est un peu une question de principe. D’abord, fêter les retrouvailles : Aoyama-Miyazaki après leur révélation conjointe Eureka et Aoyama-Asano après l’inédit Helpless en 1996. Depuis, le premier est devenu un cinéaste dandy rock capable de purs coups de génie et l’autre l’acteur le plus musicien, ingénieur du son (Café Lumière), classieux et pince sans rire du cinéma japonais. Ensuite, saluer un pitch de fumeurs de moquette : un groupe de musique noise expérimentale va sauver le monde infesté par le syndrome du lemming qui pousse tout le monde à se suicider. Enfin, applaudir le titre tout aussi invendable qui enrobe le tout, que l’on prononcera « Eli Eli machin truc » à l’avenir. Mais surtout, passé ces postulats, oublions les scories qui font que Aoyama ne sera jamais un maître pour ne retenir que le plus beau.
Par exemple, il fait encore partie de ces cinéastes qui filment une minute le jour qui se lève sur le visage d’une jeune fille endormie. Ou le sourire qui naît péniblement sur la bouche de l’ours Tadanobu Asano. La première et la dernière demi-heure sont somptueuses. Aoyama cherche à filmer le son qui passe dans l’air et entre les plans de son film et parfois on peut admettre qu’il y arrive. Entendre le son, c’est une affaire de technique (pas de souci, le film est une joie pour les oreilles), le filmer c’est un des plus grands écueils du cinéma, coincé entre le clip, la captation de concert et le documentaire musical. Aoyama fait du son un personnage : il le regarde grandir, courir, se calmer, s’énerver. Et il offre à Tadanobu Asano une carte blanche de 20 minutes aux deux tiers du film pour célébrer une réunion quasi familiale (toujours la grande affaire du cinéma japonais) entre son personnage de grand frère idéal, celui de l’ado pure et dépressive et le papa son qui va protéger le monde. C’est peut dire que Aoyama réussit parfois à sublimer les poncifs.
 Donc, pendant 20 minutes, Asano joue et le film s’envole. Extase de pur cinéma, de montage en liberté, de frontières abolies. Ecrin aussi construit autour d’un des plus beaux visages du monde, celui d’Aoi Miyazaki. Elle apparaît dans le film comme la 8ème merveille du monde. Fabuleux plan qui part d’un tunnel pour aboutir sur un remblai de station balnéaire, sur lequel la déesse est transportée par brancard, son visage protégé du soleil par un parapluie. Dans le cinéma japonais, la pauvre est écartelée entre niaiseries où faire la cruche (Nana, qui sort cet automne, a l’air un sommet) et films d’auteur que personne ne voit chez elle, où elle est sommée de tirer la tronche, éventuellement pendant 4 heures dans Eureka. Une fois par film, elle a le droit de pousser une mémorable gueulante, de hurler que dans cette tête si pure et encore si jeune (20 ans) c’est peut être l’enfer. Dans Eli Eli truc, Aoyama intercale un plan d’une seconde à peine sur son visage aux yeux bandés, de face, pressurisé au centre d’un maelström d’images en plan souvent extra larges, au milieu d’une étendue d’herbes vaste comme Eureka. Rien que pour ce plan et une dizaine d’autres parmi 1000, Aoyama reste un cinéaste dont on surveillera le prochain fumage de moquette.
Donc, pendant 20 minutes, Asano joue et le film s’envole. Extase de pur cinéma, de montage en liberté, de frontières abolies. Ecrin aussi construit autour d’un des plus beaux visages du monde, celui d’Aoi Miyazaki. Elle apparaît dans le film comme la 8ème merveille du monde. Fabuleux plan qui part d’un tunnel pour aboutir sur un remblai de station balnéaire, sur lequel la déesse est transportée par brancard, son visage protégé du soleil par un parapluie. Dans le cinéma japonais, la pauvre est écartelée entre niaiseries où faire la cruche (Nana, qui sort cet automne, a l’air un sommet) et films d’auteur que personne ne voit chez elle, où elle est sommée de tirer la tronche, éventuellement pendant 4 heures dans Eureka. Une fois par film, elle a le droit de pousser une mémorable gueulante, de hurler que dans cette tête si pure et encore si jeune (20 ans) c’est peut être l’enfer. Dans Eli Eli truc, Aoyama intercale un plan d’une seconde à peine sur son visage aux yeux bandés, de face, pressurisé au centre d’un maelström d’images en plan souvent extra larges, au milieu d’une étendue d’herbes vaste comme Eureka. Rien que pour ce plan et une dizaine d’autres parmi 1000, Aoyama reste un cinéaste dont on surveillera le prochain fumage de moquette.