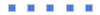De la scène au grand écran, plus fort, plus grand, plus sombre... 
Jihei le marchand de papier et Koharu la prostituée s’aiment. Malheureusement Jihei est marié à Osan et Koharu « appartient » au tenancier de la maison de luxure où elle officie. Puisque Jihei est incapable de racheter la liberté de son amante et qu’il ne semble pas y avoir d’issue possible à leurs vaines amours, le couple n’a d’autre possibilité d’union que celle qui est conférée par la mort.
On ne saurait compter les films nippons adaptés plus ou moins directement de la scène traditionnelle japonaise (qu’il s’agisse de pièces de kabuki ou de bunraku), tant les exemples sont nombreux. Certaines adaptations sont mythiques : Les 47 Rônins par exemple… Il est même un certain nombre d’œuvres dont la trame est originale ou inspirée de la littérature romanesque mais dont la mise en scène doit beaucoup au Kabuki et ses décors déconstructibles par exemple (on peut citer pour ce cas le magnifique film de Kinoshita Keisuke, la Ballade de Narayama). Cependant, rares sont les films qui seront allés aussi loin sur la voie du théâtre que Shinoda Masahiro et son Double Suicide à Amijima.
Cette œuvre, adaptée d’une pièce de bunraku de Chikamatsu Monzaemon (1653-1724, immense dramaturge considéré comme le Shakespeare nippon), vient battre et dépasser le kabuki sur son propre terrain en installant une trame classique de giri-ninjo (confrontation des aspirations et devoirs contradictoires d’un même individu) au sein de décors peints et stylisés qui ne peuvent qu’évoquer la scène de l’art dramatique le plus populaire de l’histoire de l’archipel.
Là, le spectateur assiste à l’inexorable cheminement vers le shinju (figure éminemment romantique et caractéristique de l’imagerie classique nippone qui consiste au suicide d’une paire d’amants qui ne peuvent s’unir qu’à travers la mort) du couple de Jihei et Koharu, manipulé et instrumentalisé par un destin funeste qui ne leur laisse guère d’expectative puisque le sort annonce à Jihei la fin qui sera la sienne dès les premiers instants du film. Ce procédé très théâtral contribue entre mille autres à renforcer le fatalisme de l’œuvre ; ainsi peut on voir à l’écran (et ce durant tout le film) les « kurago », c'est-à-dire les hommes entièrement vêtus et masqués de noir qui manipulent les poupées du théâtre bunraku (et ici les acteurs vivants ce qui ne fait que les conforter dans leur condition de figures impuissantes et ballottées par la fatalité).
Ces personnages inhabituels qui représentent à la fois l’œil omniscient de l’auteur, du spectateur et surtout du Destin rendent parfaitement à l’écran la morale fataliste de Chikamatsu, qui veut que les individus soient inévitablement sacrifiés s’ils se refusent à se conformer au moule social que leur impose la société nippone. Bien sûr les personnages peuvent toujours tenter de s’enfuir en cassant et renversant les murs des décors (magnifiquement peints, ils renforcent grandement l’ambiance désolée de l’oeuvre et évoquent ceux du légendaire Cabinet du Docteur Caligari, l’expressionnisme en moins) quand leur désarroi atteint un sommet, cela ne fait qu’élargir la scène sur laquelle se joue le drame.
L’extrême théâtralisation de l’ensemble qui gagne jusqu’au jeu des acteurs rend donc la démarche de Shinoda Masahiro absolument passionnante, d’autant plus que son approche est teinté d’un cynisme qu’on retrouve à son paroxysme dans le pré-générique où le cinéaste se plait à apparaître et annoncer la fin du couple tandis que les kurago mettent en place les marionnettes et le cadre de la tragédie. Ce sentiment s’exprime parfaitement à travers les regards des manipulateurs de marionnettes, perpétuellement braqués sur les protagonistes et au détour desquels la trame prend une allure critique à l’égard de la société japonaise traditionnelle et renforce l’absurdité du geste de Koharu et Jihei à coup de pathos et d’enchaînement de plans très courts quand l’ensemble est particulièrement peu découpé ce qui, au fil des (nombreux) travellings latéraux renforce l’idée décidemment omniprésente que tout s’écoule fatalement vers l’inéluctable suicide.
Double Suicide à Amijima est donc une œuvre fascinante, tant par les qualités intrinsèques de la pièce originale de Chikamatsu que par la mise en scène pleine d’abstraction et l’approche très originale de Shinoda Masahiro qu’on a malheureusement trop souvent tendance à oublier quand il s’agit de dresser la liste des hommes forts de la Nouvelle Vague japonaise. Espérons que le récent beau succès du très réussi Owl’s Castle rafraîchira les mémoires parfois trop oublieuses des cinéphiles.
De l'audace nait aussi l'ennui.
C'est dans sa théâtralité extrême que
Double Suicide trouve ses forces, son aura quasi mystique et sa volonté de décoder totalement le drame Mizoguchien par excellence en y apportant la touche inédite d'impliquer au sein même du récit et du cadre la présence des marionnettistes du Bunraku, véritables fantômes mais aussi acteurs à part entière. Les voir progresser sur la scène -de théâtre- à pas légers montre aussi que Shinoda ne veut pas trop les imposer sur scène, comme si ils n'étaient qu'ombre, mais une ombre en totale interaction avec l'univers proposé. Ils déplacent les acteurs, symbolisés au départ par des marionnettes que l'on apperçoit sur le plateau de tournage du film conférant là aussi une dimension tout à fait inédite. Et si le parti pris formel de Shinoda a de quoi rebuter, par ses longs plans-séquences -Mizoguchien?- il n'en respire pas moins l'audace d'un Oshima de la grande et belle époque de
Shinjuku Thief. Mais cette forme bien ancrée dans l'esprit Nouvelle Vague, voulu et initié par des cinéastes comme Oshima, Yoshida ou Masumura se retrouve ici du fait de son absence totale de convention, où deux pôles bien différents finissent par se rejoindre : cette forme pleine de toupet et ce récit d'un classicisme Mizoguchien où l'on retrouve ces femmes de dos, résignées, mais aussi ces nombreuses séquences d'intérieur et cette fin faisant tout droit penser aux
Amants Crucifiés en option plus dark et plus maîtrisée d'un point de vue formel.
Cependant si l'oeuvre de Shinoda est très recherchée visuellement, elle peut agacer par l'interprétation trop théâtrale de ses acteurs, trop hermétique, trop vieillotte malgré le contexte "nouveau". On retrouve les "clichés" des femmes d'un certain âge aux dents noires, cette dramatisation exacerbée et ces longs monologues déprimants. Mais ceci est voulu car si l'on fait abstraction du format, du montage et des 24 images par seconde, Double Suicide est une pièce de théâtre. On doit quelques admirables séquences à l'audace dont fait preuve Shinoda, comme ce décor interchangeable avec pièce tournoyante, faisant office de chapitrage, comme pour remplacer la technique du montage -cinéma- et rapprocher davantage le théâtre du 7ème Art. Quoiqu'il en soit cette mission est réussie, mais l'oeuvre reste difficilement accessible pour quiconque ne s'attend pas ou n'assume pas cette proximité.