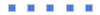

| El Topo | 4  |
Le plus beau Fukasaku ? |
| Ordell Robbie | 3.75  |
Surchauffe |
| Xavier Chanoine | 3.5 | Fukasaku déjà en grande forme au service d'un polar efficace |


 Blackmail is my life, c'est déjà du pur FUKASAKU bien avant ses chefs d'oeuvre seventies. Déjà parce qu'on y retrouve ses thèmes favoris: la vision au vitriol du miracle économique japonais au travers de personnages marginaux et butés -ici des maîtres chanteurs qui veulent s'approprier l'argent généré par le décollage économique du Japon à leur manière forte-, les fortunes douteuses qui ont pu naître sur les ruines du Japon de l'immédiat après-guerre, la dénonciation des liens entre le monde des yakuzas et le milieu politique. Et aussi pur FUKASAKU dans son style. Parce que le film est un des plus expérimentaux stylistiquement du bonhomme, une oeuvre qui peut s'apprécier en tant que festival du style FUKASAKU. Ici, tout est surmultiplié: les caméras à l'épaule, les coups de zooms, les fameux téléobjectifs qui ont fait la réputation du cinéaste, ses cadrages penchés, ses arrêts sur image reproduits à l'infini.
Blackmail is my life, c'est déjà du pur FUKASAKU bien avant ses chefs d'oeuvre seventies. Déjà parce qu'on y retrouve ses thèmes favoris: la vision au vitriol du miracle économique japonais au travers de personnages marginaux et butés -ici des maîtres chanteurs qui veulent s'approprier l'argent généré par le décollage économique du Japon à leur manière forte-, les fortunes douteuses qui ont pu naître sur les ruines du Japon de l'immédiat après-guerre, la dénonciation des liens entre le monde des yakuzas et le milieu politique. Et aussi pur FUKASAKU dans son style. Parce que le film est un des plus expérimentaux stylistiquement du bonhomme, une oeuvre qui peut s'apprécier en tant que festival du style FUKASAKU. Ici, tout est surmultiplié: les caméras à l'épaule, les coups de zooms, les fameux téléobjectifs qui ont fait la réputation du cinéaste, ses cadrages penchés, ses arrêts sur image reproduits à l'infini.
 Et qu'à cette expérimentation-là s'ajoute celle sur les couleurs: on passe ici du noir et blanc à la couleur en plein milieu d'un flash back, les effets de style cités plus haut sont parfois combinés à des filtres monochromatiques. Oui, c'est de la surenchère qui n'a rien à envier aux multiples coups de zooms de certains giallos signés FULCI mais elle finit par emporter le morceau. Surtout lorsque FUKASAKU n'hésite pas comme son compère SUZUKI à nous traîner dans les boites en vogue d'un Japon pop où les riffs rock'n'roll déchirent l'atmosphère ou à filmer des jets de cocktails molotov dans le noir. La limite c'est que FUKASAKU cherche aussi à faire sa surenchère sur le plan narratif en multipliant les flashbacks au risque de finir par rendre le récit embrouillé et de négliger de vraiment développer sa dimension politique qui affleure parfois derrière le déjà vu de film noir. Heureusement qu'un casting béton comme à l'habitude chez le cinéaste -MATSUKATA Hiroki, TANBA Tetsuro- permet au spectateur de s'attacher aux personnages malgré tout. Et puis quel plaisir de réentendre le thème musical de Tokyo Drifter...
Et qu'à cette expérimentation-là s'ajoute celle sur les couleurs: on passe ici du noir et blanc à la couleur en plein milieu d'un flash back, les effets de style cités plus haut sont parfois combinés à des filtres monochromatiques. Oui, c'est de la surenchère qui n'a rien à envier aux multiples coups de zooms de certains giallos signés FULCI mais elle finit par emporter le morceau. Surtout lorsque FUKASAKU n'hésite pas comme son compère SUZUKI à nous traîner dans les boites en vogue d'un Japon pop où les riffs rock'n'roll déchirent l'atmosphère ou à filmer des jets de cocktails molotov dans le noir. La limite c'est que FUKASAKU cherche aussi à faire sa surenchère sur le plan narratif en multipliant les flashbacks au risque de finir par rendre le récit embrouillé et de négliger de vraiment développer sa dimension politique qui affleure parfois derrière le déjà vu de film noir. Heureusement qu'un casting béton comme à l'habitude chez le cinéaste -MATSUKATA Hiroki, TANBA Tetsuro- permet au spectateur de s'attacher aux personnages malgré tout. Et puis quel plaisir de réentendre le thème musical de Tokyo Drifter...
Mineur et baclé d'après son auteur, il s'agit pourtant d'un jalon essentiel de son oeuvre d'un point de vue stylistique.
 A l'heure où Fukasaku était bien loin de sa période la plus créative, il signait déjà un brûlot efficace contre la société et l'économie du pays, dans une époque semble t-il contemporaine. Kamikaze Club c'est l'histoire de quelques paumés aux idées utopiques, anarchistes et inconscients de leurs faits et gestes. Pour gagner leur vie aisément, ils décident de monter complots et chantages contre la mafia locale afin d'y récupérer par la suite quelques millions de yens. Fukasaku dépeint au travers de ce portrait sociétal une situation accablante : les majors sont corrompus, les brigades de police sont incapables et les journalistes vont jusqu'à espionner leurs hôtes sans le moindre scrupule et la gente modeste peut s'attaquer à n'importe quel bandit. Tout est possible et Fukasaku le démontre avec un regard non sans ironie : le récit désenchanté est ponctué par la voix off du héros principal, Muraki, ancien barman et laveur de chiottes, narrant avec humour son propre destin. Cette idée de mise en scène est dans l'ensemble merveilleuse et réussit à nous décrocher quelques sourires notamment lorsque Muraki reconnaît sa parole de travers envers un boss yakuza lui proposant d'acheter son silence : "Tu n'as rien entendu", Muraki saisit le billet, poursuit par un impertinent "Je ne peux rien vous garantir", arrêt sur image Fukasakien et Muraki en voix off de dire "Là, j'avais dit une connerie". S'en suit un passage à tabac renversant dans tous les sens du terme. Cette technique de mise en scène et cette approche décalée du polar traditionnel ne tarderont pas à représenter le style si cher de son auteur qui même quarante ans après n'a pas perdu le centième de sa modernité, où audaces formelles débridées et propos particulièrement virulents en marge de la société étaient la marque de fabrique, le repère des cinéastes de la nouvelle vague enclenchée par Oshima et Masumura.
A l'heure où Fukasaku était bien loin de sa période la plus créative, il signait déjà un brûlot efficace contre la société et l'économie du pays, dans une époque semble t-il contemporaine. Kamikaze Club c'est l'histoire de quelques paumés aux idées utopiques, anarchistes et inconscients de leurs faits et gestes. Pour gagner leur vie aisément, ils décident de monter complots et chantages contre la mafia locale afin d'y récupérer par la suite quelques millions de yens. Fukasaku dépeint au travers de ce portrait sociétal une situation accablante : les majors sont corrompus, les brigades de police sont incapables et les journalistes vont jusqu'à espionner leurs hôtes sans le moindre scrupule et la gente modeste peut s'attaquer à n'importe quel bandit. Tout est possible et Fukasaku le démontre avec un regard non sans ironie : le récit désenchanté est ponctué par la voix off du héros principal, Muraki, ancien barman et laveur de chiottes, narrant avec humour son propre destin. Cette idée de mise en scène est dans l'ensemble merveilleuse et réussit à nous décrocher quelques sourires notamment lorsque Muraki reconnaît sa parole de travers envers un boss yakuza lui proposant d'acheter son silence : "Tu n'as rien entendu", Muraki saisit le billet, poursuit par un impertinent "Je ne peux rien vous garantir", arrêt sur image Fukasakien et Muraki en voix off de dire "Là, j'avais dit une connerie". S'en suit un passage à tabac renversant dans tous les sens du terme. Cette technique de mise en scène et cette approche décalée du polar traditionnel ne tarderont pas à représenter le style si cher de son auteur qui même quarante ans après n'a pas perdu le centième de sa modernité, où audaces formelles débridées et propos particulièrement virulents en marge de la société étaient la marque de fabrique, le repère des cinéastes de la nouvelle vague enclenchée par Oshima et Masumura.
 D'ailleurs le rapprochement entre Kamikaze Club et l'oeuvre débutante d'Oshima est précieux, là où Oshima dressait un portrait nihiliste et utopique de la jeunesse, Kamikaze Club ne fait que le confirmer huit ans plus tard (les dix premières minutes explicites montrent des "jeunes" qui en ont marre), ce qui explique aussi le côté avant-gardiste d'Oshima sur la société, sur son pays. Il est aussi intéressant de noter la volonté de Fukasaku de codifier un genre nouveau, d'imposer un style au polar traditionnel par son savoir-faire évident, souvent hallucinant compte tenu de l'époque à laquelle le film a été tourné. Nous ne sommes pas dans les midseventies et pourtant Fukasaku livre un véritable récital de ce qu'il entreprendra à l'avenir sans pour autant le magnifier davantage. Tout son cinéma est déjà bien là, ses téléobjectifs nombreux, ses basculements de caméra, ses changements de couleurs donnant un surplus d'âme poétique aux flash-back, ses féroces arrêts sur image et son montage cut mais cohérent apportent un nouveau souffle au cinéma de genre. Enfin, évoquons les deux superbes titres d'exploitation, "Blackmail" est sa définition du chantage explicitée par le héros lui-même "faire chanter c'est ma vie" et Kamikaze Club pour l'inconscience et l'utopie des actes. Ils reflètent parfaitement l'esprit originel et le climax voulu par le cinéaste, nihiliste au possible et au final désenchanté. Tout le monde ne peut pas s'attaquer au milieu sans être sûr d'y perdre des plumes, mais quand on est jeune, tout semble possible. Oui, tout "semble"...
D'ailleurs le rapprochement entre Kamikaze Club et l'oeuvre débutante d'Oshima est précieux, là où Oshima dressait un portrait nihiliste et utopique de la jeunesse, Kamikaze Club ne fait que le confirmer huit ans plus tard (les dix premières minutes explicites montrent des "jeunes" qui en ont marre), ce qui explique aussi le côté avant-gardiste d'Oshima sur la société, sur son pays. Il est aussi intéressant de noter la volonté de Fukasaku de codifier un genre nouveau, d'imposer un style au polar traditionnel par son savoir-faire évident, souvent hallucinant compte tenu de l'époque à laquelle le film a été tourné. Nous ne sommes pas dans les midseventies et pourtant Fukasaku livre un véritable récital de ce qu'il entreprendra à l'avenir sans pour autant le magnifier davantage. Tout son cinéma est déjà bien là, ses téléobjectifs nombreux, ses basculements de caméra, ses changements de couleurs donnant un surplus d'âme poétique aux flash-back, ses féroces arrêts sur image et son montage cut mais cohérent apportent un nouveau souffle au cinéma de genre. Enfin, évoquons les deux superbes titres d'exploitation, "Blackmail" est sa définition du chantage explicitée par le héros lui-même "faire chanter c'est ma vie" et Kamikaze Club pour l'inconscience et l'utopie des actes. Ils reflètent parfaitement l'esprit originel et le climax voulu par le cinéaste, nihiliste au possible et au final désenchanté. Tout le monde ne peut pas s'attaquer au milieu sans être sûr d'y perdre des plumes, mais quand on est jeune, tout semble possible. Oui, tout "semble"...