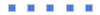Hussain Haniff en quatre films
Découvert au cours d’une rétrospective consacrée au cinéma de Singapour et de Malaisie au Centre Pompidou à Paris, le cinéaste Hussain Haniff est considéré aujourd’hui comme l’un des artisans majeurs des studios Cathay-Keris, reconnu pour ses films « modernes » tournés de 1961 à 1965, année de l’indépendance de Singapour. Malheureusement, le cinéaste décèdera prématurément peu après son dernier film, le mélodrame
Amour et affection.
Amour et affection
Tourné en 1965,
Amour et affection est un mélodrame formellement classique et narrativement laborieux. Partant sur un pitch de départ clair, il est question de lassitude au sein d’un couple de gens aisés (Nazir, un célèbre peintre et sa femme Normah), s’orientant vers le drame à mesure que la déception et la solitude de Normah prennent de l’ampleur. Dans la même ville, Jamal s’occupe de son entreprise de vente de voitures et, entre sa femme et ses enfants encombrants, voit son cœur chavirer face à la beauté de Normah et sa permanente impeccable. Il va alors tenter de séduire la jeune femme, il faut dire plutôt jolie, par tous les moyens possibles quitte à mentir à sa famille.
Jusque là peu surprenant, le plus dérangeant dans cet
Amour et affection (qui en aurait bien besoin) est la manière dont les situations et les enjeux sont agencés. Sans finesse aucune, la manière dont s’oriente le cercle amoureux fait preuve d’une telle superficialité qu’il est proprement impossible de toucher le spectateur. Premièrement, la mise en scène du film est aberrante puisqu’ellipses et hors-champs sont aux abonnés absents durant les presque deux heures du métrage. Deuxièmement, l’interprétation sans saveur aucune ne donne que peu d’épaisseur aux personnages : le peintre Nazir, affublé de grosses lunettes et d’un béret pour faire « artiste » est ridicule de A à Z, sa femme, Normah, n’est impliquée dans aucune scène digne d’intérêt (hormis l’amusante noyade en fin de métrage) si ce n’est de reprocher à son mari de se coucher tard, d’aller chez le coiffeur ou de se balader. Enfin, Jamal, passe son temps à interpréter son personnage de gros boulet affolé par les beaux yeux de Normah, joue les papa-poule avec ses gosses en prenant soin de savoir s’ils ont mangé à midi, et s’occupe d’un client ou deux lorsqu’il est au travail. Pas loin, quelques jeunes beaux gosses narcissiques qui tentent de draguer la belle Normah.
Lorsque mise en scène et interprétation sont au raz des pâquerettes, il reste toujours l’écriture pour sauver les meubles. Déception, le film touche le fond par son absence totale d’enjeux dramatiques malgré le fait qu’il soit un mélodrame. C’est bien simple, il ne se passe strictement rien pendant une heure et demi, avant l’épisode musical de la noyade, drôle car tellement kitsch. On assiste, atterré, à un enchaînement de séquences insignifiantes, où l’on discute de tout et de rien sans que le film avance : Jamal séduit Normah, Normah va chez le coiffeur ou pleure un peu, les gosses parlent à papa au téléphone, Nazir par en voyage d’affaires, Jamal invite Normah au restaurant et lui achète un haut tout neuf, tout ce qui se rapproche de près ou de loin du mélodrame est absent. Il faudra attendre le déménagement de Jamal et sa famille pour Singapour alors que l’homme en pince pour Normah afin d’y voir des éléments au potentiel mélodramatique véritable, pourtant, le traitement est si robotique et les émotions si transparentes qu'
Amour et affection n’est jamais touchant. Jamal et sa famille partent en train, on n’en parlera plus, Normah n’y pensera plus. Chacun rentre chez soi ou essaie de refaire sa vie. L’épilogue, le moment le plus drôle du film, épate par son côté hors-sujet incroyable, mémorable transition kitsch musicale donnant un peu de saveur à un produit qui « vient de loin ». Il aura fallut que Normah commence à se noyer pour que son peintre vienne à son aide et qu’elle comprenne qu’elle l’aime encore, et que son histoire avec Jamal était une erreur. L'adultère, une tentation du diable. Et dire que les filles autour d’elle continuent de patauger sans réagir à ses appels à l’aide. Une séquence maladroite sauvant finalement
Amour et affection du naufrage total. Rarement un mélodrame n’aura été aussi insipide malgré la beauté incandescente de l’actrice Fatimah Ahmad.
Les Voisins du village
Au rayon mélodrame à portée vaguement sociale,
Les Voisins du village, tourné la même année, demeure un bon produit sous cellophane. Mieux emballé qu’
Amour et affection,
Les Voisins du village sonde les mœurs et coutumes d’habitants d’un village où les différentes générations ne se comprennent plus à une époque où Singapour, à présent indépendant, arborait des atouts de plus en plus modernes. Nous sommes dans les années 60, tournant culturel important du 20ème siècle avec notamment l’avènement du rock’n’roll et son influence sur les pays du monde entier. Période cruciale pour la libéralisation des mœurs chez les plus jeunes qui ne manquera pas de faire rouspéter les anciens, à l’image de ces mères de familles montrées sous un angle ultra protecteur et culturellement rétrograde : leurs fils ne doivent pas sortir avec des filles peu fréquentables –c'est-à-dire pauvres ou exubérantes- et ne doivent surtout pas s’adonner aux plaisirs d’une baignade à deux, sous peine d’essuyer les remarques désagréables. Entre autres.
Contrairement au médiocre
Amour et affection qui ne réussissait jamais à intéresser,
Les Voisins du village réussit à embrayer bien plus rapidement puisque l’intrigue de base, également inintéressante car ne donnant jamais les moyens d’intéresser pleinement du fait d’une répétitivité et d’un manque d’enjeux dramatiques évidents (tout le monde n’est pas Ozu), se voit éclipser au bout d’une heure par un viol d’un villageois quelque peu honteux. Voyeur et profitant de son inquiétante corpulence, le vilain profitera de la faiblesse de la belle Rohani pour la souiller et briser ses ambitions amoureuses. Au film alors de trouver une énergie brouillonne presque jouissive, bien aidée par un montage chaotique donnant toute sa saveur à une séquence de poursuite entre le médecin de la jeune femme et son violeur, aux relents bis plutôt bien gérés. Cette énergie fait oublier la première heure blindée de discussions typiques de villageois pas plus intéressantes que celle que l’on a avec nos propres voisins, et fait culminer le film vers une dramatisation incroyablement intense…pour pas grand-chose. C’est toute la différence entre les mélodrames maîtrisés et ceux qui utilisent les codes du mélodrame poignant –de l’interprétation à l’utilisation de la musique et du cadre- pour n’aboutir à rien, à l’image de cette conclusion à l’hôpital habitée par une tension terriblement menaçante (le jeune homme va-t-il poursuivre avec sa petite amie alors qu’elle s’est faite violée ?) tombant dans le happy-end total où tout le monde viendrait au chevet de la victime pour la recouvrir de câlins et de cadeaux. Mais à la différence d’
Amour et affection, le film réussit à divertir par son caractère nonchalant et peu soucieux de la nuance et de la cohérence des émotions.
Hang Jebat
Dans le registre du divertissement pur, le premier film de Hussain Haniff,
Hang Jebat, parvient à montrer combien le cinéma malais folklorique d’époque pouvait être un sacré vivier d’histoires tragiques et spectaculaires sans tout à fait les moyens de leurs ambitions. On est en effet à des années lumières des grandes fresques romanesques d’Hollywood ou du Japon, puisque cette adaptation des aventures de deux personnages importants du folklore malais et indonésien porte déjà les traits caractéristiques du cinéma de Hussain Haniff : une interprétation en totale roue libre des personnages de Hang Jebat et Hang Tuah, des élans mélodramatiques soudains et des passages chantés qui amènent à l’idée que le cinéma local d’époque devait marier les genres et les émotions le plus souvent possible au sein d’un même film. C’est pourquoi, le mélodrame de base n’est jamais souvent cohérent avec ses propos puisqu’en plein milieu d’une crise de larmes on y verra de jeunes gens danser le twist ou frôler la mort en dix minutes chrono. Bien sûr, ici, se frôlent délicatement mélodrame mièvre (accompagné de chansons racontant combien il est difficile de trouver l’amour), parabole sur le pouvoir et la richesse, politique, vengeance et tragédie quasi Shakespearienne autour d’un massacre orchestré par un Hang Jebat désireux de venger l’exécution de Hang Tuah, alors que celui-ci est en fait cloîtré dans un bungalow, toujours vivant. Autant dire que les producteurs de la Cathay-Keris misent tout sur le film à portée politique joliment décoré pour toucher un maximum de personnes.
Hang Jebat est un exemple sidérant, où la morale douteuse consiste à expliquer qu’il est préférable de tuer un traitre qui a trahis le sultan, et qu’importe si ce même traitre est un ami ou un frère. Le grand défaut du film, avec un regard d’aujourd’hui, est alors de mettre en scène des héros aussi braves que détestables dans le fond. Et toutes ces guirlandes pour faire joli ne masquent pas cette vilaine morale.
Hussain Haniff mise alors sur les tourments des héros pour exposer la grandeur de leur cœur : « dois-je tuer mon frère, lui qui a trahis le sultan ? ». Malheureusement le jeu d’acteurs des deux héros est si caricatural qu’il est difficile de croire en ces revirements de situation de dernière minute avant, pendant et après l’affrontement entre les deux héros, l’un étant envoyé par le sultan pour assassiner l’autre. Hussain Haniff ne faisant pas les choses à moitié, le combat final entre les deux frères représente un évènement à lui tout seul, sorte de chorégraphie kitsch où les coups de poignards n’atteignent jamais leur cible pendant près de vingt minutes insoutenables de crétinerie. Retombons en enfance, à l’époque où nous jouions aux chevaliers avec de fausses épées, tout en inventant des rebondissements incroyables pour faire durer le jeu, le résultat à l’écran est identique : deux gosses s’amusent à sauter dans des décors en carton-pâte, s’évitent volontairement pendant dix plombes, se lamentent sur leur sort, pleurnichent, acceptent le retour à la raison pendant un court instant avant de reprendre le combat parsemé de rires démoniaques et d’envies de tuer tout ce qui bouge. Allez comprendre les états d’âme de ces héros-là. Encore une fois, le résultat aurait pu être très drôle, il restera consternant car trop long, mal découpé, terriblement mal joué et avec dans son ombre une morale vilainement rétrograde et un final lacrymal au possible. On mettra cela sur le compte d’une compilation d’effets destinés à émouvoir l’audience de l’époque, mais aujourd’hui,
Hang Jebat n’a même pas le côté divertissant du pire péplum Cinecitta, malgré des qualités de filmage étonnamment supérieures à ce que fera Hussain Haniff quatre ans plus tard.
Mat le cinglé
On connaît donc le versant dramatique et épique du cinéaste, cependant le registre de la comédie pure est encore un mystère. Au départ réalisateur du pilote d’une série télévisée intitulée
Mat le cinglé, dont le personnage principal est interprété par Mat Sentol (l’une des plus grandes stars comiques des années 60 en Malaisie), Hussain Haniff laissera finalement sa place à ce dernier pour transposer l’épisode au format long.
Mat le cinglé est une comédie sur les mésaventures d’un marginal qui ne cesse de provoquer des catastrophes autour de lui. Après avoir finalement trouvé un toit sous lequel s’abriter, il rentre en contact avec l’esprit des lieux qui lui propose d’exhausser un de ses vœux. Gourmand et peu gêné, Mat demandera femmes et nourriture à foison avant d’évoquer le souhait d’être riche et puissant, sans se soucier d’où peut provenir les sous. D’emblée, l’une des rares qualités de cette comédie navrante est de jouer autour de la dimension fantastique des souhaits exhaussés par les génies folkloriques, en ne faisant pas apparaître de l’argent créé par magie mais en le dérobant spirituellement d’une banque. C’est un peu comme si le génie d’Aladdin recouvrait son protecteur de pièces d’or volées. Une idée malheureusement jamais exploitée à des fins comiques, permettant à Mat d’aller faire un tour en prison et de faire le mariol avec les gardes, sans jamais réussir à être drôle.
Pourquoi une telle comédie, pourtant interprétée par l’une de ses figures les plus populaires, s’avère être au final irritable au possible? Un problème culturel ou encore générationnel ? Les impressions laissées après la projection ? La sensation d’avoir assisté à un bide, ni plus ni moins. Une immense déception que l’on doit en partie aux idées humoristiques faiblardes, faussement burlesques, sans doute appréciables au temps du muet mais qui, affublées de dialogues ridicules, et malmenées par un Mat Sentol insupportable de cabotinage, perdent paradoxalement de leur pouvoir comique. Une comédie agaçante, qui plus est interminable et totalement vaine malgré son déluge de gags censés être drôles dans leurs intentions, pas bien aidée par une galerie de protagonistes crétins, laissant pourtant apparaître de temps à autres des personnages féminins dont la beauté irradie l’écran : la caméra semble même hésiter à ne serait-ce que frôler ces anges, notamment la princesse Habibah venue se perdre dans un défilé de prétendants au mariage, transformé en cirque pour l’occasion.
Hussain Haniff, grand cinéaste aujourd’hui incompris du grand public ? Si la question peut être posée, là n’est pas l’intérêt d’un compte rendu de quatre de ses films, éparpillés à travers de courtes années démontrant ainsi l’évolution de son cinéma et de ses codes. Si
Hang Jebat ne contient pas encore les thématiques importantes du cinéaste, il est sans doute l’un des films les plus complets de son auteur malgré son approche, aujourd’hui, aberrante d’une légende du folklore malais et indonésien. On y trouve pourtant, au-delà de la thématique de la vengeance, toute la dimension de rébellion entrevue plus tard dans ses mélodrames sociaux, où l’on se rebelle non pas contre l’état monarchique mais contre la société. Conflits entre les générations, conflits envers une société de plus en plus moderne ne laissant que peu de place, finalement, aux traditions à la fois religieuses et sociales. On aurait d’ailleurs pu craindre une place importante accordée à la religion, mais Hussain Haniff ne s’en sert pas comme motifs particuliers. Tout juste note-t-on dans
Les Voisins du village, l’indignation d’un oncle se rendant à la mosquée lorsqu’il croise ce couple de jeunes gens modernes, légèrement vêtus, définitivement dans l’air du temps.
Soucieux d’exprimer à travers le médium cinéma son ressenti face à l’essor spectaculaire d’un Singapour à présent indépendant, le cinéaste jouera avec humour et dérision autour des symboliques étroitement liées au développement, comme cette femme capricieuse désirant une grosse berline moderne pour changer l’épave actuelle, entre autres. Plus proche du registre du burlesque, malgré ses thèmes ancrés dans le mélodrame, le jeu d’acteur chez Hussain Haniff semble être symbolique de la volonté des producteurs de la Cathay-Keris d’y voir en chaque film un potentiel de spectacle total, sans rigueur particulière ou cohérence. On se sentirait presque au théâtre guignol, avec des figures masculines aussi bien autoritaires que complètement gaga du moment qu’une jolie fille aurait le malheur de croiser leur chemin. Particulièrement évident dans
Amour et affection, l’homme est considéré comme un radar sexuel, clignotant à la moindre proie en vue. Même chose dans
Mat le cinglé, où ce dernier essuie les refus de beautés spectaculaires malgré des tentatives d’intimidation et de séduction par le biais de la chanson, astuce et petite touche de couleur locale que l’on retrouve dans les quatre films vus à l’occasion. Quant à la figure féminine, elle oscille entre mère possessive, femme adultère, trompée ou violée, capricieuse ou méprisable. Tout un programme. Des personnages de drame finalement importants dans le cinéma de Hussain Haniff malgré leur utilisation caricaturale et guère moderne, un paradoxe quand on voit à quel point le cinéaste confronte modernité et mœurs conservatrices, techniques de cinéma modernes (notamment dans
Hang Jebat, paradoxalement le plus moderne des quatre) et lourdeurs préhistoriques, gags à gogo mais jamais drôles, combats épiques mais ridiculement chorégraphiées, ce cinéma-là démontre combien toute la bonne volonté du monde ne suffit pas toujours pour en faire un tout un minimum prenant. Véritable curiosité pour qui la cinématographie de Hussain Haniff est encore un mystère, elle se paie cependant au prix d’une amère déception générale.
Photo en provenance du programme du Centre Pompidou