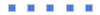


En dépit de toutes le critiques qui lui sont faites, Last Life in the Universe est un moment planant particulièrement succulent. Beaucoup critiquent Pen-Ek parce qu'il fait du sous Tsai Ming-Liang, pioche chez ce dernier et chez Wong Kar-Wai, joue pas mal sur la pose. Certes, d'un côté ce n'est pas un mal rayon "citations", mais de l'autre, ce n'est pas non plus de sa faute si des cinéastes ont fait parler d'eux avant parce qu'ils jouaient eux aussi sur la pose pour exacerber les sentiments des personnages ou pour faire transparaître la moiteur de l'univers dépeint. Et de dire que Pen-Ek n'a pas grand chose à raconter dans ce que l'on peut considérer comme son premier vrai film auteurisant, est une erreur. La rencontre hasardeuse entre deux paumés n'est pas certes ce que l'on a trouvé de plus original dans l'histoire du cinéma, mais le traitement de ces derniers donne toute la saveur à ce superbe drame intimiste, chronique d'une vie, du passage d'une vie comme l'aurait fait Ozu. Sauf que chez Pen-Ek, les protagonistes sont seuls, passent leur temps à séjourner dans une baraque en ruine, tentent de communiquer malgré les barrières de la langue ce qui rend d'autant plus touchant toute tentative plus ou moins faussée de créer le plan "drague". Kenji (Tadanobu Asano) est puceau et s'excite rapidement rien qu'en ayant la tête de Noi sur ses cuisses, pourtant sa timidité l'empêche de prendre les devants à la fois parce qu'il ne sait pas s'y prendre question drague, et parce que la jeune femme avec qu'il passe son temps vient de perdre sa soeur, le choc émotionnel étant encore bien présent. Les deux personnages se rejoignent tous les deux du fait de le perte d'un membre de leur famille, et si l'on peut éprouver une certaine compassion face à Noi (la belle a perdu sa soeur, renversée par une voiture), personne ne peut éprouver la même sensation avec Kenji, qui a perdu son frère, chez lui, liquidé par un yakuza. Point de compassion parce que son frère n'était qu'un profiteur mal poli. Schématiquement le film est en revanche très classique, Kenji et Noi vont se rencontrer dans le hall d'un immeuble puis se lieront d'amitié naturellement. L'un cherche sans pour autant forcer une personne à qui parler, l'autre accepte et trouvera un intérêt chez elle : à la fois calme, timide et respectueux des valeurs qu'il ne connaît pas réellement (à part quelques civilités, Kenji ne sait pas du tout parler le thaïlandais), il est aussi un être protecteur pour Noi. La confrontation des cultures donne lieu à de beaux moments de cinéma contemplatifs : l'omniprésence de la cassette audio japonaise/thaïlandaise, les petits jeux linguistiques à table, les deux tourtereaux allongés sur le canapé devant un film de série B thaï , le côté désordonné (thaï) et maniaque (japonais) s'unissant dans un nettoyage de printemps rehaussé de science-fiction (les pages et livres qui volent), les parties de Dance-Dance Revolution, cliché du Japon tendance pop qui permet pourtant de rassembler les deux personnages, et la musique discrète mais planante qui recouvre chaque scène.
Mais ce Last Life in the Universe n'est pas qu'un drame intimiste pour festivals, même si ses détracteurs nous prouveront par A+B le contraire (sans avoir franchement tord non plus soit dit en passant) et permet de vriller le temps de vingt minutes vers le film de gangster cheap mais pas vide de sens non plus. Car chez Pen-Ek, une scène sensée apporter un minimum de force à un ensemble volontairement lent n'est pas fortuite : la scène d'assassinat entre le yakuza joué par Takeuchi Riki et le frère de Kenji n'est pas là pour faire jolie, et sa répercussion n'interviendra qu'une heure plus tard, comme si Pen-Ek voulait effacer toute la quiétude et le relatif "bonheur" qui vivent Kenji et Noi. Et parce qu'un final qui se solderait simplement par un « au revoir » à l'aéroport n'aurait fait que du Lost in Translation version Som Tam. Non, Last Life in the Universe bascule donc dans le grotesque (qui n'est pas un terme ici négatif) et le scatologique, et n'allez pas dire que c'est à cause de la présence de Miike Takashi qui livre un caméo plus intéressant que chez Matsuo Suzuki ou l'arnaque Roth! Le décalage apporte à la fois sa petite sensation (notamment sur ce plan de la vitre brisée dans les toilettes annonçant le pire) mais le souffle qu'il fallait pour que le film de Pen-Ek soit "marquant". Chez Tsai Ming-Liang on aurait déjà eu la corde au cou ou pris un rendez-vous chez le psy depuis longtemps, chez Pen-Ek, on a le sourire et la sensation d'avoir vécu un moment à la fois zen (de part les paysages, l'attitude de Noi et la prestance d'Asano) mais aussi très souvent épicé (la froideur clinique de certains environnements, la menace du bad guy ex-petit ami "de passage" de Noi) et surtout particulièrement bien mis en scène par Doyle, qui fait du Doyle jusqu'à plus soif certes, mais qui offre des plans supra classes qui font très logiquement de Last Life in the Universe un grand film dans le genre. C'est super poseur, mais que diable !
Un film de rencontre dans lequel il ne se passe finalement pas grand chose, mais avec le souci du détail qui rend l'ensemble très attachant. L'originalité du personnage principal aide finalement beaucoup, le choc des cultures apporte également son lot d'exotisme, la mise en scène travaillée réserve quelques très bons moments. Le gros point fort du film est surtout d'arriver à rendre le couple principal attachant en étant justement très détaché d'eux. On ne connaît finalement pas grand chose des deux personnages principaux, et la caméra est toujours très distante du couple. Très peu de gros plans sont utilisés, mais sans que cela n'installe vraiment une distance avec les personnages. L'utilisation de la musique est un autre point fort, elle se substitue parfois aux bruitages et joue un rôle important dans l'ambiance du film. La touche d'humour est également bienvenue et évite au film de tomber dans la lourdeur dramatique. Enfin on ne sait pas vraiment comment tout cela va se finir, ce qui est toujours une qualité dans le cinéma actuel. Bref, un petit film de personnages soigné et intelligent.
Il s'en faut de peu pour que Last Life in the Universe soit du foutage de gueule surproduit, léché pour amateurs de cinéma asiatique en mal de spleen, en attente des maitres taiwanais et pendant que Wong Kar-wai se prend pour Coppola. Cette production thai-japono-hollando-française essaie d'atteindre la mélancolie moite d'un Tsai Ming-liang, mais quand on voit un aquarium à poissons dans le coin d'un cadre large, on a le droit de crier au pompage. A WKW, le film a piqué son chef op star, Christopher Doyle. Il s'est bien amusé à faire des images gris-bleu, mais à la longue, la torpeur aidant, on se prend à observer d'avantage la teinte des chaises d'aéroport que l'actrice posée dessus. L'appartement du japonais est donc gris-bleu et maniaquement rangé, celui de la thailandaise une porcherie colorée.
C'est, malheureusement, une des idées les plus fortes du scénario. Car, sinon, Last Life in the Universe ne raconte pas grand chose ou plaque une histoire de gangsters pour justifer une fin mélo. Grande différence avec Lost in translation, souvent cité en parrallèle de ce film: il semblait ne rien dire mais raconte une foule de petits détails qui font une rencontre. Les détails, dans Last life in the Universe, sont partout sauf dans l'essentiel : dans les décors, donc, dans la bande sonore, la musique, tout cela est très bichonné, l'ultime touche "auteur" étant de mettre le titre du film au bout d'une demi-heure. Ce doit être un tic en vogue en Thailande, puisque Apichatpong Weerasethakul l'a inauguré pour Blissfully Yours. La fille est jolie et avec de l'abbatage, en face Tadanobu Asano est volontairement éteint dans un costume évidemment gris-bleu. Il n'arrive pas non plus à être drôle dans ses tentatives de suicide à répétition. Riki Takeuchi et Takashi Miike viennent faire leurs Riki Takeuchi et Takashi Miike sans se fouler, quiconque les a déjà vu ailleurs fera, au mieux, un petit bonjour.
Dans ses précédents films, Ruang Talok 69 et Monrak Transistor, Pen-ek Ratanaruang trouvait un équilibre miraculeux entre comédie, intrigue policière et mélo, tout en gardant un côté local réjouissant. Ici, il a dilué son art dans le lounge arty. En fait, rien n'est vraiment mauvais dans ce film : mais tout aurait pu être tellement mieux.
Last Life in the Universe, c'est de la carte de visite. Carte de visite bien fournie d'ailleurs et propre à ratisser large rayon cinéma d'auteur panasiatique: Christopher Doyle qui nous refait sa seconde manière photographique qu'on qualifiera à l'emporte pièce de période bleue déjà dégainée pour Andrew Lau et Peter Chan, Japon aux étages star aux choix artistiques "crédibles" (Asano Tadanobu), acteur fétiche d'un cinéaste nippon culte (Takeuchi Riki) et enfin ce cinéaste nippon culte justement (Miike Takashi). Le tout mis en boite par un cinéaste qui s'est fait assez remarquer à Cannes à l'époque où les buzzers du cinéma made in Asia lassés de leurs vieux Dragons ayant perdu leur lustre d'antan (HK, Japon) et de leurs Dragons apparus plus récemment sur la scène cinéphile mondiale (Taïwan, Corée) jetaient leur dévolu sur la Thaïlande. Avec pour résultat un produit de la mondialisation du cinéma version cinéma d'auteur surfant sur une idée festivalière du cinéma asiatique des années 90 dans son versant "modernité cinématographique à la sauce soja" plutôt que contemplatif. En vrac le thème de la solitude urbaine vu chez Wong Kar Wai et tous ses suiveurs et ce jusqu'au récent Sofia C au sujet voisin qui par le hasard des sélections se retrouvait à Venise dans la même section et comme lui y raflera un Prix d'Interprétation. Sans compter la wongkarwayisation de la Thaïlande par une mise en scène ultrastylisée et des angles de cadrages aussi improbables que déjà vus chez le Hongkongais, le travail sur le son devenu ingrédient indispensable de tout film asiatique "à sensations". Et enfin un vague dispositif autour du désir de suicide donnant les scènes les moins réussies d'un film un peu meilleur quand il s'en écarte, en particulier dans sa seconde partie où Asano reprend goût à la vie.

L'équation que le film n'arrive pas à résoudre, c'est celle du courant mondialisé dans lequel il se trouve, de ces films aux influences formelles et thématiques multiples dont le poids risque d'empêcher l'édification d'un style personnel. On cherche en effet en vain ici un élément dans le scénario, dans l'assemblage des influences, dans la thématique, dans la mise en scène et le cadrage qui fasse dépasser au film la compilation du déjà vu ailleurs. SPOILER Seule la fin sort un peu de cette routine: plaisante parce que sortant le film de sa routine festivalière en parachutant des yakuzas kitaniens en Thaïlande en produisant un peu de collision donc de personnalité, gênante parce que même si préparée par le plan sur le tatouage d'Asano elle donne l'impression de faire pièce rapportée dans le film. FIN SPOILER. Reste que les personnages ne sont pas vraiment développés et que c'est du tape à l'oeil visuel, thématique et de corps. Même s'il se regarde une fois sans déplaisir, il ne s'agit donc de rien de plus que d'un film mode.
Ce n'est pas avec ce film que le cinéma thaïlandais va produire le genre de coups de tonnerres sur le cinéma mondial qu'ont pu faire en leur temps Hong Kong ou le Japon ni sortir le cinéma d'auteur d'Extrême Orient de l'impasse des formatages festivaliers. Tout simplement parce que Ratanaruang y fait ce que la Corée a trop souvent tendance à faire avec son cinéma populaire: faire une compilation de tout ce qui marche ailleurs en recopiant plutôt qu'en recyclant vraiment. Dommage car son joli mais parfois poseur Monrak Transistor sentait bon une certaine idée du cinéma populaire (naiveté, mélange des genres) en voie de disparition en Asie...

 Injustement reparti bredouille du festival de Deauville 2004, Last life in the Universe prouve qu’il faudra compter dans le futur avec la Thaïlande, et Pen-ek Ratanaruong en particulier, sur le plan cinématographique mondial. D’une maîtrise formelle remarquable, Last life… cultive sans jamais défaillir l’ironie et le burlesque, et fait mouche pratiquement à tous les coups. Le couple improbable formé par un Tadanobu Asano en grande forme, dont le vague à l’âme et les cheveux dans les yeux font irrémédiablement penser à Johnny Depp, et la très belle Sinijtra Boonyasak sur le fil du rasoir entre fatalité et espoir secret, est réellement attachant et, bien que l’action soit relativement lente, on ne s’ennuie jamais. Ratanaruong prend son temps, le temps de percer la carapace de ses personnages, de les comprendre et de faire partager leurs sentiments au spectateur. Un grand souffle de liberté vient rafraîchir la seconde partie du film : les contraintes de la vie quotidienne s’éloignent (rangement, justification des morts de l’appartement de Kenji,...) pour laisser la place aux rêves de bonheur de ces 2 êtres que le passé n'a pas épargné. Et si on parvient à s’accrocher au wagon, le voyage en vaut vraiment la peine.
Injustement reparti bredouille du festival de Deauville 2004, Last life in the Universe prouve qu’il faudra compter dans le futur avec la Thaïlande, et Pen-ek Ratanaruong en particulier, sur le plan cinématographique mondial. D’une maîtrise formelle remarquable, Last life… cultive sans jamais défaillir l’ironie et le burlesque, et fait mouche pratiquement à tous les coups. Le couple improbable formé par un Tadanobu Asano en grande forme, dont le vague à l’âme et les cheveux dans les yeux font irrémédiablement penser à Johnny Depp, et la très belle Sinijtra Boonyasak sur le fil du rasoir entre fatalité et espoir secret, est réellement attachant et, bien que l’action soit relativement lente, on ne s’ennuie jamais. Ratanaruong prend son temps, le temps de percer la carapace de ses personnages, de les comprendre et de faire partager leurs sentiments au spectateur. Un grand souffle de liberté vient rafraîchir la seconde partie du film : les contraintes de la vie quotidienne s’éloignent (rangement, justification des morts de l’appartement de Kenji,...) pour laisser la place aux rêves de bonheur de ces 2 êtres que le passé n'a pas épargné. Et si on parvient à s’accrocher au wagon, le voyage en vaut vraiment la peine.