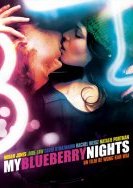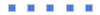

 Contre toute attente, j'ai été agréablement surpris par ce film. J'ai naturellement une affinité pour les road movie et celui-ci ne déroge pas à mon goût. Une jolie histoire d'une fille qui passe une année à voyager au travers des États-Unis pour faire le vide dans sa tête et se redécouvrir. Norah Jones est vraiment touchante, toujours dans son personnage, à la fois timide et naïve. Jude Law assure son coté, tout comme Natalie Portman et David Strathairn ; seule Rachel Weisz a l'air un peu exagérée mais sans réellement gêner. En outre, certains choix de mise en scène sont particulièrement inutiles ; comme les plans saccadés qui font plus mal aux yeux qu'apporter un intérêt, mais certaines idées étaient bien trouvées, comme la vue par la caméra dans le coin du bar, sans pour autant en abuser. Et coté musique, c'est tout simplement impeccable ; les choix sont parfaits, collant au poil avec leurs scènes respectives. Non vraiment, ce WKW a du charme et j'avoue ne pas comprendre les critiques qui descendent celui-ci tout en s'émerveillant devant 2046.
Contre toute attente, j'ai été agréablement surpris par ce film. J'ai naturellement une affinité pour les road movie et celui-ci ne déroge pas à mon goût. Une jolie histoire d'une fille qui passe une année à voyager au travers des États-Unis pour faire le vide dans sa tête et se redécouvrir. Norah Jones est vraiment touchante, toujours dans son personnage, à la fois timide et naïve. Jude Law assure son coté, tout comme Natalie Portman et David Strathairn ; seule Rachel Weisz a l'air un peu exagérée mais sans réellement gêner. En outre, certains choix de mise en scène sont particulièrement inutiles ; comme les plans saccadés qui font plus mal aux yeux qu'apporter un intérêt, mais certaines idées étaient bien trouvées, comme la vue par la caméra dans le coin du bar, sans pour autant en abuser. Et coté musique, c'est tout simplement impeccable ; les choix sont parfaits, collant au poil avec leurs scènes respectives. Non vraiment, ce WKW a du charme et j'avoue ne pas comprendre les critiques qui descendent celui-ci tout en s'émerveillant devant 2046.
 On commençait à se poser la question avec 2046, maintenant on en a la confirmation: Wong Kar Wai, aussi talentueux soit-il, commence un peu à tourner en rond. Car même en s'expatriant aux USA, il répète les mêmes recettes en s'approchant parfois de l'auto-parodie. Le talent est toujours là, mais il est difficile de répéter sans cesse les mêmes schémas avec la même efficacité. My Blueberry Nights n'est pas un mauvais film, mais de Wong Kar-Wai, on attend autre chose qu'un road movie sympa.
On commençait à se poser la question avec 2046, maintenant on en a la confirmation: Wong Kar Wai, aussi talentueux soit-il, commence un peu à tourner en rond. Car même en s'expatriant aux USA, il répète les mêmes recettes en s'approchant parfois de l'auto-parodie. Le talent est toujours là, mais il est difficile de répéter sans cesse les mêmes schémas avec la même efficacité. My Blueberry Nights n'est pas un mauvais film, mais de Wong Kar-Wai, on attend autre chose qu'un road movie sympa. 
 Il n'y a guère que 3 idées intéressantes dans My Blueberry Nights :
Il n'y a guère que 3 idées intéressantes dans My Blueberry Nights :
- La caméra de vidéosurveillance qui sert de journal intime au barman, lequel se repasse le soir certains moments de la journée pour se rendre compte de toutes les occasions manquées. On est là dans la droite ligne du camescope de Kaneshiro dans Fallen Angels, mais aussi du Smoke de Wayne Wang quand Harvey Keitel prenait chaque jour la même photo de son échoppe pour mesurer le temps qui passe, ce qui donnait lieu à un émouvant recueil d'images.
- La réflexion de Norah en quittant Las Vegas, selon laquelle les autres nous servent parfois de miroir pour mieux se découvrir et se comprendre.
- Le happy end final, surprenant chez un Wong d'habitude plus pessimiste, mais un happy end particulier puisque le contact entre les 2 amoureux se fait en état d'inconscience pour l'un d'eux.
Pour le reste, My Blueberry Nights frôle l'indécence jusqu'au malaise. Une entrée en matière très perturbante évoquant un remake raté de Chungking Express et se permettant même la reprise du thème de In the Mood for love, des cadrages et une photo très maîtrisés mais paradoxalement très artificiels, puis une virée dans la Vallée de la Mort totalement incongrue via des personnages sans intérêt. Je me posais la question de l'inspiration de Wong après un 2046 d'une complexité folle mais qui atteignait les limites de son discours, persuadé qu'il aurait beaucoup de mal à se renouveler. Ce film ne fait que confirmer mon appréhension. Espérons néanmoins qu'il réussisse à se ressaisir dans les prochaines années...

12 ans après, les anges sont toujours déchus. Leurs histoires s’entremêlent et leur avenir est toujours aussi incertain.
 Le dispositif du film est plus que jamais esthétique et discursif, comme en témoigne avec force le premier plan, au générique. Une tarte aux myrtilles est filmée en très gros plan au point de dissoudre presque complètement l’analogie figurative au corps référent. Le procédé n’est pas sans rappeler Blow Up d’Antonioni mais l’usage est très différent. La caméra caresse, observe soigneusement la tarte. Les myrtilles sont humides, goutteuses, tendres et donnent à l’image un caractère charnel, organique, vivant que nuance légèrement en des reflets synthétiques la lumière se déposant sur le sucre caramélisé. La crème glacé, blanche, coule alors sur l’ensemble. Au début, une légère surexposition donne l’impression que l’image est entrain de fondre sous nos yeux, rappelant à nos souvenirs le travail de Monte Hellman à la fin de Macadam à 2 voies . Mais la matière froide de la crème reprend le dessus, et s’écoulant dans l’image et sur la tarte, elle unifie le tout en un ensemble cohérent. Le cinéma est ainsi, une matière plastique (du polyester) qui, dans les mouvements de la lumière, prend vie : le cinéma composé d’images indépendantes comme un corps frankesteinien, sous l’impulsion de la lumière, s’anime en un mouvement d’ensemble et vivant.
Le dispositif du film est plus que jamais esthétique et discursif, comme en témoigne avec force le premier plan, au générique. Une tarte aux myrtilles est filmée en très gros plan au point de dissoudre presque complètement l’analogie figurative au corps référent. Le procédé n’est pas sans rappeler Blow Up d’Antonioni mais l’usage est très différent. La caméra caresse, observe soigneusement la tarte. Les myrtilles sont humides, goutteuses, tendres et donnent à l’image un caractère charnel, organique, vivant que nuance légèrement en des reflets synthétiques la lumière se déposant sur le sucre caramélisé. La crème glacé, blanche, coule alors sur l’ensemble. Au début, une légère surexposition donne l’impression que l’image est entrain de fondre sous nos yeux, rappelant à nos souvenirs le travail de Monte Hellman à la fin de Macadam à 2 voies . Mais la matière froide de la crème reprend le dessus, et s’écoulant dans l’image et sur la tarte, elle unifie le tout en un ensemble cohérent. Le cinéma est ainsi, une matière plastique (du polyester) qui, dans les mouvements de la lumière, prend vie : le cinéma composé d’images indépendantes comme un corps frankesteinien, sous l’impulsion de la lumière, s’anime en un mouvement d’ensemble et vivant.
Loin des citations gratuites, Wong Kar Wai ouvre enfin l’âme de son cinéma. Peu importe les histoires spécifiques à chacun de ses films, c’est dans l’émulsion globale, humaine et organique de la matière filmique que Wong Kar Wai pose ses émotions. Si nous reconnaissons bien des histoires dans les traits de My Blueberry Nights, c’est pour la richesse de ses états, de ses personnages fantomatiques qui traversent son œuvre et dépassent le corps de leurs interprètes. Pourquoi reconnaissons nous dans le personnage de Jude Law, s’asseyant sur le bar pour manger une part de tarte, celui de de Kaneshiro dans Fallen Angels ? Parce qu’au delà de l’acteur qui fait de son corps un réceptacle le personnage qui passe de film en film, de corps en corps reste le même. Voici donc ce que devient Charlie lorsqu’elle découvre que l’homme qu’elle aime est avec une autre. Nous comprenons enfin (pour une part) pourquoi Andy Lau était si triste dans Days of Being Wild…
Le cinéma de Wong se construit sur un réseau d’êtres affectifs qui ne prennent de sens que dans les raccords, tant intellectuels qu’émotifs que le spectateur fait entre les motifs de ses différents films. En cela, My Blueberry Nights s’annonce comme l’incontournable de cette fin d’année. Il est une occasion de laisser filer ses émotions au rythme des images, confirmant par là ce que j’imaginais : Il n’est qu’une raison d’agresser ce film en se prétendant « wongien », se croire plus important que le film, se sentir dépassé, presque humilié par la richesse de ses images et ne pouvoir les contenir dans notre pauvreté personnelle. Il est évident que My Blueberry Nights ne s’adresse pas à tout le monde, qu’il ne répond pas à la sensibilité de tous. Je suis moi-même imperméable à bon nombre de choses, à certains films… ceci est un ensemble honnête et cohérent. Mais c’est une toute autre histoire que de se prétendre de cette sensibilité là, celle de « l’esthétique Wong Kar Wai », ou du « cinéma Wong Kar wai » puisque son cinéma est avant tout une puissance esthétique (Cf. Gilles Deleuze, Différences et répétitions), et de cracher sur un film qui en est l’incarnation… Le beau témoignage que voilà, presque un aveu dirait on…
 Il est parfois effrayant de voir combien l'un des cinéastes les plus importants d'HongKong puisse perdre autant de son jus lorsqu'il franchit l'océan pacifique pour rallier le continent de l'oncle Sam. Pesons nos mots, Wong Kar-Wai a réellement apporté au cinéma HongKongais durant les années 90, de sa maestria intrinsèque alliée à une équipe solide (Chris Doyle, William Chang) aux scripts toujours inspirés associés aux conditions extrêmes de tournage, tout ceci n'est plus dans My Blueberry Nights, insignifiante bluette cucul la praloche où l'on ressort, pour la première fois devant une oeuvre signée Wong Kar-Wai, particulièrement indifférent. Ce n'est pas la faute à Norah Jones, pas plus mauvaise et inutile qu'une Rachel Weisz insupportable sur toute la ligne, ce n'est ni la faute à un Jude Law plutôt impeccable. Le problème vient de la recette de cette tarte aux myrtilles, dans la mesure où le scénario ne fait jamais montre d'audaces et dit définitivement non à l'imprévu tant le film semble millimétré jusque même dans la gestuelle de ses interprètes : Jude Law et Norah Jones s'épongeant leur nez en sang ou Jones réconfortant Rachel Weisz après son pétage de câble n'en sont qu'une partie. Mais ce manque de souplesse, ce manque d'imprévus annihilent ce qui faisait jusque là la force du cinéaste dans les années 90, car même si In the Mood for Love annonçait un virage artistique certain, appuyé par le superbe 2046, nul ne pensait voir un tel naufrage.
Il est parfois effrayant de voir combien l'un des cinéastes les plus importants d'HongKong puisse perdre autant de son jus lorsqu'il franchit l'océan pacifique pour rallier le continent de l'oncle Sam. Pesons nos mots, Wong Kar-Wai a réellement apporté au cinéma HongKongais durant les années 90, de sa maestria intrinsèque alliée à une équipe solide (Chris Doyle, William Chang) aux scripts toujours inspirés associés aux conditions extrêmes de tournage, tout ceci n'est plus dans My Blueberry Nights, insignifiante bluette cucul la praloche où l'on ressort, pour la première fois devant une oeuvre signée Wong Kar-Wai, particulièrement indifférent. Ce n'est pas la faute à Norah Jones, pas plus mauvaise et inutile qu'une Rachel Weisz insupportable sur toute la ligne, ce n'est ni la faute à un Jude Law plutôt impeccable. Le problème vient de la recette de cette tarte aux myrtilles, dans la mesure où le scénario ne fait jamais montre d'audaces et dit définitivement non à l'imprévu tant le film semble millimétré jusque même dans la gestuelle de ses interprètes : Jude Law et Norah Jones s'épongeant leur nez en sang ou Jones réconfortant Rachel Weisz après son pétage de câble n'en sont qu'une partie. Mais ce manque de souplesse, ce manque d'imprévus annihilent ce qui faisait jusque là la force du cinéaste dans les années 90, car même si In the Mood for Love annonçait un virage artistique certain, appuyé par le superbe 2046, nul ne pensait voir un tel naufrage.
La mise en scène, rassurante lorsque l'on connaît la belle inspiration de Wong Kar-Wai, semble ici constamment surfaite et use de tics Doyliens qui n'apportent définitivement rien à la dynamique d'ensemble. La caméra sur épaule nerveuse et particulièrement incisive des années passées trouvait sa justification et était riche en sens dans la mesure où elle contribuait à instaurer le chaos, ici Darius Khondji sous la houlette de Wong Kar-Wai récite du Doyle sans âme et si Wong Kar-Wai affirme avoir confié à son chef opérateur de faire un travail personnel, les influences Doyliennes sont là, cette caméra naviguant derrière des objets et parois vitrées, cette utilisation du ralenti assommante car assénée avec lourdeur, un travail globalement esthétisé à l'extrême n'apportant rien à la dynamique d'ensemble, juste pour faire joli. Le spectateur amusé par tant de niaiserie esquissera quelques sourires face aux rencontres sentimentales déjà vues dans la moitié des sitcoms américains (et l'on retrouve le texan moyen, le patron de snack gueulard, le flic dépressif, la punk lolita en décapotable), rigolera un peu gêné devant la faiblesse des dialogues (dont une réplique finale que Lorie n'aurait pas reniée) jusqu'à sortir perplexe en fin de projection. Wong Kar-Wai a pris ses vacances pour le tournage de My Blueberry Nights et si la patte du cinéaste est bel et bien là, elle ne donne jamais corps à l'ensemble, parait trop démonstrative pour un tel sujet (simple road movie sentimental), Wong Kar-Wai doit alors fournir un script suffisamment audacieux voir explosif pour que son style s'y adapte dans un pur soucis de cohérence. Imaginez Tarkovski mettre en scène un script de Woody Alen. Imaginez Tsui Hark sur du Lelouch. Non, n'imaginez pas.