Rendez-vous régulier depuis sept ans pour les cinéphiles et curieux de la capitale, le festival Paris Cinéma s’est tenu dans plusieurs cinémas de Paris pour douze jours bien remplis. La grande nouveauté de cette année était la possibilité de passer sa nuit dans un cinéma de son choix pour un programme particulièrement éclectique. Outre l’opportunité de voir sur grand écran des bisseries turcs au cinéma Max Linder, l’Asie était représentée dans deux autres cycles. A quelques kilomètres de là se tenait la Nuit cinéma d’animation japonais avec la projection dès minuit de trois films d’animation en copie 35mm. Une exclusivité. Enfin, près de Beaubourg, les plus vicieux d’entre nous avaient déjà pris rendez-vous au cinéma Nouveau Latina pour une série de cinq films de fesses (sur le papier) diffusés dans de bonnes conditions malgré la projection d’un Better Than Sex amusant mais dont l’image grise et salement définie ne faisait que confirmer la mocheté d’une projection dvd en salle de cinéma.
, Taïwan.
Ce fut tout de même mieux que rien, jeunes et anciens découvraient les yeux grand écarquillés une comédie loufoque où l’on suivait les pérégrinations d’un « petit branleur » et d’une équipe de télévision japonaise en pleine chasse aux racailles, entre autres. Le jeune Li a du mal avec les filles du fait de la taille démesurée de son sexe, sa seule manière de contourner la chose est d’entrer directement dans le milieu du X, où il fera la rencontre d’un vendeur de magazines de fesses, détenteur d’une collection inestimable. Ce dernier le guidera dans son parcours initiatique jusqu’à la demeure d’une poseuse. Pendant ce temps là, trois types sèment la zizanie sur leurs motos, poursuivis par la police et une équipe d’animateurs pour la télévision japonaise. L’enfance de Li le rattrapera également avec la réapparition de celle qui l’aimait, devenue gothique après avoir essuyé le refus de celui pour qui elle craquait. Dans un bordel cosmique un peu fauché, lorgnant du côté de la comédie thaï, ce carrefour de rencontres improbables ne vaut pas grand-chose cinématographiquement mais déploie sa belle énergie durant les 90 minutes que constituent le métrage, mêlant comédie salasse et romance nostalgique jusqu’à culminer dans un final gore dans le plus pur style manga. Au final presque
touchant, on n’évitera pourtant pas les excréments, chers à toute bonne comédie grasse digne d’Hongkong.
Quelques avis :
Omoide Poroporo de
TAKAHATA Isao
Tokyo Godfathers de
KON Satoshi
Les Joyeux pirates de l'île aux trésors de
IKEDA Hiroshi
Compétition internationale longs métrages
Cette année, une dizaine de films étaient présentés. L’Asie n’avait pas la force du nombre puisque deux films étaient en compétition, le rude
Breathless de Yang Ik-Jun (Lotus d’Or à Deauville Asia) et la comédie satirique
Sell Out ! du cinéaste malaisien Yeo Joon-Han, présentée à la 65
ème Mostra de Venise.
Breathless, Corée du Sud.
Pour son premier film, Yang Ik-Jun ne fait pas les choses à moitié quitte à se complaire dans la violence la plus sèche et la plus désarmante au prix de choquer ou, comme il l’expliquait, raconter ce qui se passait dans les quartiers qu’il fréquentait étant jeune. Le cinéaste expliquait également que Breathless est loin de dépeindre la réalité en Corée, et invitait tout le monde à venir passer un moment là-bas. Pas sûr qu’il trouvera nombre de clients après cette expérience cinématographique tour à tour éreintante et éprouvante, distillant à petite doses un peu d’humanité entre les poings et les crachats. Derrière sa carapace de dur à cuir, Sang-Hoon cache un profond malaise depuis son enfance qui vit sa famille se décimer peu à peu sous ses yeux. Devenu une crapule adepte du racket, il bosse pour les comptes d’un patron avec qui il échange régulièrement des mots doux, tout en entretenant une véritable relation de confiance. Son destin va alors être chamboulé au moment où il rencontre par hasard une lycéenne qui aura eu le malheur de croiser son chemin. Alors qu’il crache partout, la jeune fille reçoit malencontreusement un de ses molards en plein sur sa cravate, avant de répliquer de la même manière et de recevoir une prune la mettant K.O. On ne rigole pas avec Sang-Hoon. Tous deux vont alors entretenir une relation guère courtoise mais complice, bouleversant leurs destins.
 On peut émettre des réserves sur le caractère du film. Pas le caractère qui lui est propre, entre rage non soutenue et constat navrant d’une société qui connait la crise –de nerfs, mais le caractère général de l’œuvre, sa faculté à libérer les coups à un rythme fatiguant, à enchaîner les mots doux avec un certain dynamisme. C’en est presque de l’art à ce niveau. L’art de la vulgarité formelle, des mots, du corps. Mais pourtant, outre cette manie de balancer le spectateur de gauche à droite en le foutant sur les murs comme un petit caïd qui menacerait le premier faible du coin, Breathless cache une sensibilité évidente, une haine due en partie à quelque chose, quelqu’un, quelque part. Yang Ik-Jun lâchera quelques pistes au fur et à mesure que le film avance et que ses personnages distribuent des coups, un procédé pas de plus innovants mais collant bien au style du film vidé de toute substance saine. A l’image de ses personnages marginaux supportant la crise, le spectateur prend un coup sur la tête face au filmage secoué, salement enivrant, parfois brouillon lorsqu’il tente de coller au plus près des personnages. On pourrait donc crier au manque de distance face à ceux qu’ils vivent, comme une sorte de complaisance/voyeurisme fait attraction malsaine. « Voyez ce que je dépeins, c’est sale et pas joyeux, hein ? », une réplique digne du premier peintre de réalisme social venu pour vendre son tableau en y ajoutant de grosses touches de pathos parce que sinon ça ne se vend pas. Pas assez « frappe à l’œil », pas assez coréen non plus vu qu’on ne pleure pratiquement pas de tout le film malgré tout le poids sur les épaules des personnages. La jeune Yeon-Hue doit supporter un père handicapé refusant la mort de sa femme et un petit frère autoritaire et influençable, elle trouve en Sang-Hoon une sorte de père/petit ami capable de la faire sortir du trou d’où elle vit ; c’est aussi pour cela qu’ils s’arrangent souvent pour aller boire un verre quelque part pour fuir le monde dans lequel ils vivent, tous deux partageant en quelque sorte les mêmes blessures familiales issues de la violence ou d’accès de folie. Dispersés ça et là dans le récit, les flash-back sont à ce stade bien employés.
On peut émettre des réserves sur le caractère du film. Pas le caractère qui lui est propre, entre rage non soutenue et constat navrant d’une société qui connait la crise –de nerfs, mais le caractère général de l’œuvre, sa faculté à libérer les coups à un rythme fatiguant, à enchaîner les mots doux avec un certain dynamisme. C’en est presque de l’art à ce niveau. L’art de la vulgarité formelle, des mots, du corps. Mais pourtant, outre cette manie de balancer le spectateur de gauche à droite en le foutant sur les murs comme un petit caïd qui menacerait le premier faible du coin, Breathless cache une sensibilité évidente, une haine due en partie à quelque chose, quelqu’un, quelque part. Yang Ik-Jun lâchera quelques pistes au fur et à mesure que le film avance et que ses personnages distribuent des coups, un procédé pas de plus innovants mais collant bien au style du film vidé de toute substance saine. A l’image de ses personnages marginaux supportant la crise, le spectateur prend un coup sur la tête face au filmage secoué, salement enivrant, parfois brouillon lorsqu’il tente de coller au plus près des personnages. On pourrait donc crier au manque de distance face à ceux qu’ils vivent, comme une sorte de complaisance/voyeurisme fait attraction malsaine. « Voyez ce que je dépeins, c’est sale et pas joyeux, hein ? », une réplique digne du premier peintre de réalisme social venu pour vendre son tableau en y ajoutant de grosses touches de pathos parce que sinon ça ne se vend pas. Pas assez « frappe à l’œil », pas assez coréen non plus vu qu’on ne pleure pratiquement pas de tout le film malgré tout le poids sur les épaules des personnages. La jeune Yeon-Hue doit supporter un père handicapé refusant la mort de sa femme et un petit frère autoritaire et influençable, elle trouve en Sang-Hoon une sorte de père/petit ami capable de la faire sortir du trou d’où elle vit ; c’est aussi pour cela qu’ils s’arrangent souvent pour aller boire un verre quelque part pour fuir le monde dans lequel ils vivent, tous deux partageant en quelque sorte les mêmes blessures familiales issues de la violence ou d’accès de folie. Dispersés ça et là dans le récit, les flash-back sont à ce stade bien employés.
S’il n’est pas exempt de facilités dans le recours à la violence ou dans la peinture d’un quartier très modeste, Breathless n’y va pas non plus avec le dos de la cuillère quand il faut rigoler. Réservant son lot de moments assez tordants prenant forme notamment dans la représentation burlesque de la violence, Yang Ik-Jun prouve qu’il est bien de cette génération de cinéastes coréens mêlant au sein d’un même film les genres et les tons, une personnalité de cinéaste qu’on ne trouve pas souvent dans le cinéma mondial et qui arrive à exploser ici quitte à tacher les murs : d’une incroyable sècheresse, le final mêle aussi bien pessimisme gerbant et optimisme rayonnant avec d’un côté la relève avec le petit frère de Yeon-Hue et le changement de vie du patron de Sang-Hoon. Radical dans ses ambitions, un peu raté par moments, Breathless divisera.
Sell Out!, Malaisie.
Sell Out ! risque également de diviser par son humour satirique qui ne s’épuise jamais sur la durée et la caricature des personnages qu’il met en scène (gros patrons sans scrupules, starlettes, employé benêt…) malgré l’enthousiasme évident du public de Paris Cinéma, pas avare en réactions face aux énormités mises en scène par Yeo Joon-Han. Immense pamphlet plein de dérision sur la consommation et l’audimat, Sell Out ! évoque le combat de deux être au profil bien différent. Eric est un employé de la société Fony Electronics (une puissante entreprise rappelant à peine Sony) où il tente de concevoir des machines révolutionnaires. Ses patrons, obsédés par le profit, rechignent face à sa dernière trouvaille, une machine capable de faire du lait de soja uniquement avec des graines. Son invention est tellement fiable qu’elle ne les intéresse pas, le client ne pourra jamais facturer de réparation : pour que la machine soit acceptée, Eric doit trouver le moyen pour que la machine se mette en panne un jour après l’expiration de sa garantie. En parallèle, Rafflesia, une présentatrice d’émission de télévision consacrée à l’art sous toutes ses formes, travaille également pour Fony mais peine à trouver son audience. Pour rameuter les troupes et donner le sourire à ses patrons, elle vise à inviter sur son plateau une star de reality-show sans aucun talent, quitte à passer de l’art au cochon. Tous deux vont finir par se croiser et tenter l’impossible dans leur désespoir.

Eric va t-il réussir à mettre sa machine révolutionnaire sur le marché?
Réjouissant d’entrée avec une réflexion sur le cinéma d’auteur pleine de dérision, Sell Out ! ne lâchera pas pour autant cet esprit fait de liberté de ton et de mixité des genres. Sont abordés la critique des médias et son pouvoir sur la société de consommation (nous, vous), les patrons attirés par les gros sous et qui ne se soucient pas une seconde du consommateur dans le but de faire le maximum de profits, la débilité d’une émission de reality-show ou encore la publicité. Si certains personnages sont relativement détestables, en particulier la présentatrice Rafflesia, ils ne sont que des pantins du système comme pris à leur propre piège, capables de franchir des limites et d’abandonner leurs ambitions premières pour garder leur poste et faire plaisir à ceux qui les rémunèrent. Logique lorsque l’audience demande à voir autre chose qu’un cinéaste nu venu raconter qu’il fait du médium cinéma le reflet de la vie, c'est-à-dire un reflet où il ne se passe rien, comme dans la vie. On pourrait rapprocher cette idée aux cinéastes qui posent leur caméra à un endroit précis pour, au final, ne rien filmer de particulier. Que l’on se rassure, ce n’est pas le cas du film, qui arrive à faire preuve d’un panache tranquille aussi bien dans les scènes comportant un gros travail d’écriture que durant les moments plus légers, aériens, où l’on chante jusqu’à participer à un véritable karaoké, sorte d’interaction avec le film uniquement possible avec les projections hebdomadaires du Rocky Horror Picture Show à Paris. A condition de réagir face aux nappes d’humour parfois interminables et jusqu’au-boutistes, Sell Out ! fait passer un agréable moment, terminé un peu dans l’urgence pour se rendre à la séance d’en face avec le beau Hotaru de Kawase Naomi.
Invitée d'honneur : Kawase Naomi (Japon)
Deux ans après avoir reçu un premier hommage aufestival Paris Cinéma avec notamment la projection entre autres du bouleversant
Suzaku et du beau
Shara, confirmant Kawase Naomi en tant que cinéaste précieuse, la 7
ème édition honore une nouvelle fois la cinéaste, qui profite par la même occasion de la plateforme de coproduction du festival pour réaliser son prochain métrage. La cinéaste était présente pour montrer un film inédit,
Hotaru, suivi d’une discussion avec le public. Son dernier film en date, le visiblement boudé
Nanayo, était également de la partie avec une projection unique en la présence d’un des acteurs principaux, le comédien français Grégoire Colin.
Hotaru, Japon.
Hotaru est le second long métrage de Kawase Naomi. C’est son autre enfant, comme elle l’appelle, et il aura fallu dix ans avant qu’elle ne le présente aux festivals et au monde entier. Pas peu fière, la réalisatrice, forte d’une reconnaissance internationale méritée pour l’ensemble de son œuvre, à la fois humaine et pleine de chaleur bouleversante. Une fois encore, Kawase filme la région de Nara, sa région, avec toute la sensibilité qu’on lui connait depuis
Suzaku, ses courts métrages et documentaires autobiographiques. On y retrouve la pureté quasi zen des contrées mais aussi l’énergie de la ville où la cinéaste pose sa caméra pour des moments aussi intenses qu’alertes : de la ville, on verra essentiellement un établissement de strip-tease, lieu de travail de la belle et tourmentée Ayako, mais aussi une place où la « grande sœur » de cette dernière et meneuse de danse s’adonnera à une démonstration de strip hallucinée au souffle de liberté assez unique.
Hotaru effleure d’ailleurs très souvent le spectateur de son vent de liberté, du mode de vie des protagonistes au jour le jour, à mi-chemin entre conte fantastique et récit autobiographique. Pourtant,
Hotaru est une film d’une simplicité presque trop évidente sur le papier, au risque de tomber dans les travers de la cinéaste consistant à filmer pour filmer, mais heureusement l’œuvre est soutenue par un fil conducteur solide, tout aussi simple, mettant en avant les difficultés de la jeune femme à tirer un trait sur quelque chose de pas tout à fait perceptible, mais dans tous les cas palpable grâce à une mise en scène souvent proche des corps tourmentés, presque malades à l’image de son documentaire réalisé deux ans plus tard,
La danse des souvenirs.

Le four. Obstacle à leur relation naissante?
Simplement, en dehors de ses teintes ternes et ses éclairages datés au sein de l’établissement de strip-tease,
Hotaru délivre pourtant de temps à autres des séquences au vrai pouvoir hypnotique : en deux mots, l’introduction et la conclusion sont formellement inouïes, les séquences baignées dans un noir profond exacerbent la rougeur et l’incandescence extrême d’une pluie de cendres encore chaudes versées dans le ciel et ainsi exposées aux spectateurs venus assister au festival du feu de la région, une tradition. Des images non sans rappeler un des plus grands plasticiens du cinéma japonais, Oguri Kohei , où le naturel prend des allures d’œuvre poétique à part entière simplement par la souplesse du filmage qui la représente, son originalité mais également sa singularité. Car l’œuvre de Kawase, au sens large, ne représente rien de bien connu : la cinéaste filme la vie, les gens, la mort, la naissance –au sens physique et spirituel, dans un pur souci de raconter quelque chose, une expérience, une douleur, un état d’esprit. Si l’on devait encore en douter,
Hotaru est du genre mélodramatique, mais on ne parle pas ici de films qui font du lacrymal pour du lacrymal à l’image de ces dizaines et dizaines de mélodrames que l’on voit fleurir chaque année au cinéma. L’œuvre de Kawase est l’une des rares dans ce paysage sclérosé à proposer un contenu presque vital et viscéral à la fois. Certes ici la cinéaste offre ça et là des moments d’une puissance inouïe, comme le bain festif dans la fontaine publique, mais ces rares séquences émaillent un ensemble moins empli de grâce qu’à l’habitude, là aussi à l’image de
Nanayo et son manque de matière malgré des éclairs de géni redoutables d’efficacité. Des
Hotaru, Kawase Naomi pourrait en faire des dizaines, il y aurait à n’en pas douter ce même sens du cadre offert par une caméra tour à tour tourmentée comme énergique (à l’image de ses héros), cette faculté à capter la puissance spirituelle de la nature (les nappes de vent sur les herbes vertes) pour en faire un outil cinématographique à part entière. Kawase Naomi est l’une des rares cinéastes à capter ce qui n’est pas, paradoxalement, perceptible, ce qu’elle rabâche très régulièrement à chaque nouveau film attendu comme un diamant précieux que l’on rêve de tailler soi-même : on comprend son cinéma selon nos affinités. Inutile de dire que l’on se l’approprie également à notre manière.
Nanayo, Japon.
Depuis ses débuts à la vidéo, la réalisatrice Kawase Naomi a apporté au cinéma ce qu’il fallait de grâce, de légèreté et de mysticisme pour que le cinéma fasse encore rêver. Au diable donc le cinéma se définissant uniquement par la puissance des acteurs ou par la solidité d’une intrigue à tiroirs. Depuis l’émergence du cinéma d’auteur asiatique, bon nombre de cinéastes se sont essayés à la démarche de réaliser des films différents, comprenons par là sans grands acteurs connus, sans intrigue particulière, avec la revendication totale de faire du cinéma de chronique pour la chronique : filmer des personnes, filmer une ruelle bien éclairée par le chef opérateur, filmer un quotidien tendre ou désespérant. Mieux vaut se tourner vers la Chine continentale pour ce dernier exemple. Kawase Naomi se démarque de ces auteurs de la chronique pour la chronique, et même si le cinéma de cette dernière trouve une vraie définition dans l’exploitation de la nature à des fins poétiques (depuis
Katasumori en 1994 jusqu’à
La Forêt de Mogari 13 ans plus tard), la confrontation naturel/surnaturel la rapproche d’un cinéaste comme Apichatpong Weerasethakul, autre grand cinéaste inspiré lorsqu’il filme le vide, la nature, le mouvement. Et cela tombe parfaitement, Kawase Naomi pose son « intrigue » en Thaïlande, variant les niveaux d’ambiance comme pour mieux confronter l’énergie des marchés à la douceur zen des temples en pleine jungle. On retrouve une expatriée japonaise, Saiko, fraichement arrivée en Thaïlande dans le but de reconstruire une nouvelle vie après un épisode au Japon visiblement désagréable. A peine le temps de découvrir les lieux et de communiquer dans un anglais approximatif avec la population locale, la voilà embarquée dans un taxi où l’absence de communication entraîne de sérieux problèmes : se croyant attaquée après que le taxi se soit arrêté en pleine jungle, Saiko s’enfuit en laissant bagages et biens dans le coffre, tente de repousser le chauffeur de taxi qui ne semble pourtant pas lui vouloir beaucoup de mal. A la fin de son échappée, elle découvre un repère tenu par une masseuse professionnelle et son ami français. Greg, le français, la rassure et lui trouve en toute logique une place au sein de l’établissement. Accueillie et rassurée par ce dernier, le chauffeur de taxi débarque à son tour. Chacun va cohabiter à cet endroit, des liens vont se tisser, se détruire…


Le plus intéressant dans cette entreprise foutraque est que personne ne peut communiquer autrement que par les gestes –de massage en partie, ce qui donne lieu à des instants de tendresse et de franche rigolade tout au long du film. Si l’on rigole de la prononciation du mot « pluie », très délicate pour Saiko et que l’on trinque dans toutes les langues –thaïlandais, japonais, français et anglais, très vite le climat prend une toute autre tournure : une attaque subite dans un marché de nuit, virant de la peur au sentiment d’euphorie une fois les malfrats semés, rapprochera les hôtes, déliera les langues malgré une communication très souvent à sens unique. L’art de la cinéaste est d’ailleurs de convertir ces échanges en instant de grâce et d’émotion pure. Si ce pari est une fois de plus réussi, démontrant le savoir-faire de la cinéaste pour filmer le naturel et le trouble avec un sens inouïe, force est de constater le côté quelque peu vain du film dans son ensemble. Remarqué car possédant dans sa besace ça et là quelques séquences extraordinaires (les plans rapprochés sur Hasegawa Kyoko, la fuite dans le marché de nuit, la séquence d’hystérie suite à la disparition du petit d’Amari, la patronne des lieux) qui remplissent une intrigue trop molle et sans grand but si ce n’est d’étaler des tics de mise-en-scène et d’appuyer un style qui a fait ses marques depuis Suzaku. Que du bon dirait-on, mais avec du recul, cette méthode empêche Kawase Naomi d’évoluer plus encore. Le recyclage va jusque dans une danse de fin, magnifique mais incapable de nous faire oublier celle de Shara. Les discussions entre les protagonistes pourront ennuyer le spectateur le moins sensible, la faute à une interprétation trop inégale de la part de Grégoire Colin et une dernière partie s’axant bien trop sur l’avenir du petit (sera-t-il moine comme le souhaite sa mère ?), agrémentée d’une couche épaisse de rêves qui font tout sauf sens.


C’est juste très joli, cadré avec magie. Qu’importe qui signe la photo, c’est du Kawase en –beau pilotage automatique, jusque dans les éternels plans sur une flore bel et bien vivante. On aura néanmoins vu plus intense dernièrement avec La Forêt de Mogari et ses arbres qui gémissent, même si la direction du son orchestrée par Akritchalerm Kalayanamitr (Syndromes and a Century, Vagues invisibles, Ploy…) est une fois de plus enivrante. Reste que si Kawase avait jusque là l’habitude de rendre hommage au troisième âge (de ses documentaires et court-métrages personnels jusqu’à son dernier film), ici c’est l’enfance qui est mise au premier plan : d’abord la thématique de la naissance/renaissance avec la nouvelle vie de Saiko, et ensuite la question de l’avenir du petit, suscitant de vives discussions au sujet de l’importance de la religion en société pour des gamins de dix ans. Doivent-ils être embarqués dans la religion très tôt, est-ce un frein à leur épanouissement ? Des questions qui trouveront des réponses en surface, mais rien de réellement pertinent, tout juste est-ce là un prétexte à une séquence d’hystérie sidérante lorsque le petit est porté disparu depuis que ces questions ont été abordées par sa mère. Il manque donc quelque chose à Nanayo pour être un grand Kawase, car si le travail visuel et sensoriel est toujours aussi juste, et les fulgurances toujours présentes au bon moment, la sensation d’avoir affaire à un film sans grand but nous amène à penser que la cinéaste n’est pas encore prête à prendre des risques. Beau, souvent touchant, un peu vain sans doute.
Quelques mots de Kawase Naomi, à propos de Hotaru :
"La version d’Hotaru projetée ici est une version que j’ai remontée à l’occasion de sa projection au festival de Cannes cette année. C’est un film que j’ai réalisé il y a une dizaine d’années et qui n’a été montré nulle part. Ce film était jusque là resté en moi, mais en dix ans j’ai changé, et au cours de sa présentation spéciale à Cannes dans le cadre de la remise du prix du Carrosse d’or, j’ai voulu faire un montage entièrement nouveau pour présenter mon enfant au monde, avec une nouvelle vie."
"Pour le film que j’avais fait il y a dix ans, les gens qui l’avaient vu à Locarno m’avaient dit que c’était un film qui donnait l’impression que l’on peut vivre tout seul, que l’on peut découvrir la vie tout seul dans le monde, et dans la version actuelle les gens m’ont dit qu’ils avaient au contraire l’impression d’être encore plus forts lorsque l’on s’entraide et que l’aide des uns des autres était encore plus importante pour se sentir fort."
"A vrai dire ce que j’ai rajouté dans le film, ce n’était pas toute une explication sur l’univers de Daiji, mais plutôt sa rencontre, j’en ai montré davantage dans la version en principe définitive. J’ai tenté de montrer pourquoi le lien entre les deux personnages s’est renforcé et pourquoi ils sont inséparables. Je pense que dans la relation homme-femme, il n’est pas très important de savoir que Daiji soit potier. J’ai davantage mis l’accent sur leurs univers, leur relation est plus importante que le reste."
Etre réalisatrice au Japon.
"Je ne suis pas féministe, je suis même plutôt l’opposé. En ce qui concerne la raison pour laquelle il y a peu de femmes réalisatrices au Japon, je ne peux pas vraiment l’expliquer. Je veux simplement dire que le métier de réalisateur est un métier très difficile, très exigeant, très fatiguant, et puis il n’y a pas tellement de femmes autonomes et indépendantes au Japon. De plus, les femmes qui ont des enfants ont beaucoup de temps pris et ne peuvent pas éviter de passer du temps dans l’éducation de leurs enfants. Je crois que sur un tournage il faut se comporter comme un homme, c'est-à-dire avoir beaucoup d’autorité, se mettre en colère et savoir diriger les gens, ce qui n’est pas tout le temps évident pour une femme."
Destruction du four du potier.
"Je crois qu’au moment où cela survient dans le film, c’est lorsqu’ils ont découvert tous les deux que lorsque l’on a quelque chose de très important, on peut le protéger à tout prix. Pour eux, ce qui est le plus important n’était pas quelque chose de « visible » ou de « physique », mais plus la relation qui naissait entre eux. Il fallait donc détruire ce qui pouvait faire obstacle à ce qui était entrain de naître, chose beaucoup plus importante que tout, comme de trouver dans l’autre un reflet de soi-même, de sentir dans l’autre quelque chose qui était plus important que ce que l’autre faisait, c’est pourquoi Ayako a trouvé le besoin de détruire ce four. Par exemple lorsque Shoko, l’aînée, la « grande sœur », décède, elle n’est plus là physiquement mais son esprit reste là : j’ai donc montré que le plus important c’est ce que l’on ne voit pas."
La scène de nudité en pleine rue.
"A cet instant, nous n’avions pas demandé d’autorisation, cela s’est fait très vite, et il y a des gens à la préfecture qui sont encore furieux après moi malgré les dix ans qui se sont écoulés depuis ! Je crois que c’est une scène magnifique. D’ailleurs, veuillez faire une pétition auprès des gens de Nara (lieu où le film a été tourné) qui sont en colère contre moi pour avoir fait cette scène, et je vous remercie si vous la trouvez belle de le signaler !"
La signification du feu.
Une personne du public : "dans ce film, il y a beaucoup de scènes avec du feu, elles sont très belles et m’ont un petit peu fait penser au film de Yanagimachi Mitsuo qui s’appelait Himatsuri (La fête du feu), et dans votre film le feu a deux significations, celle de la purification mais aussi celle de la renaissance. Qu’en pensez-vous et quel rôle attribuez-vous à ce feu ?"
"La flamme joue un rôle très important, elle est en quelque sorte le symbole de la vie. Je pense que s’il y a des étincelles qui tombent au début du film, c’est la représentation de la vie. C'est-à-dire il y a un moment d’extrême brillance puis tout disparaît dans le noir. Le noir est tout aussi important pour faire ressortir le brillant du feu, je pense que les deux sont tout à fait nécessaires car c’est l’expression de la vie elle-même, la vie étant faite de moments brillants et d’autres plus sombres. Je pense que dans les villes modernes où il y a trop de néons, il est difficile de rencontrer l’âme sœur, peut-être parce qu’il y a trop de lumière et sans noir on ne voit pas la brillance de la vie de l’autre que l’on cherche éventuellement. C’est un peu comme l’expression qui résume à dire que si l’on n’a pas de souffrance on ne peut pas être joyeux, c’est la dualité, la vie. La flamme est la vie, et sans noir on ne voit pas la luciole qui est le sens de "hotaru"."
Propos traduits par Catherine Cadoux.
Une dizaine de films étaient diffusés en avant première cette année au festival, des films venus des quatre coins du globe. L’Asie était représentée avec trois films, le beau
Memory of Love que l’on analysera avant sa sortie en salle en complément d’une riche interview de son cinéaste Wang Chao, le
Midnight Meat Train de Kitamura Ryuhei qu’Arnaud a bien aimé si l’on en croit son avis dans le dossier spécial Gerardmer, et enfin le magnifique
Yuki et Nina du tandem Suwa Nobuhiro/Hippolyte Girardot qui signaient leur premier film réalisé conjointement après une amitié de plusieurs années déjà, et des projets plein la tête. Malgré la distance et les conditions de tournage particulières, le résultat s’est avéré unique selon Hippolyte Girardot, une expérience dont ils sont à présent incapables de renouveler selon ses dires. Et on peut le comprendre.
Yuki et Nina, France/Japon.
Yuki et Nina, le plus japonais des films français ? Le film du duo Suwa/Girardot n’a pas besoin de scénario très écrit pour exister, ni pour faire valoir son authenticité et sa faculté à mêler imaginaire et réalisme social au sein d’une même œuvre pleine de légèreté et de puissance émotionnelle. Le film a beau être filmé à hauteur d’enfant, se dérouler dans les beaux quartiers de Paris et tenir des propos volontairement naïfs, il dégage suffisamment de force et de cœur pour intéresser et captiver. Cette réussite, on la doit à l’alchimie de deux profils résolument différents, celui de Hippolyte Girardot qui s’essaye à la réalisation et à l’écriture, une première pour cet acteur français, et celui de Suwa Nobuhiro, réalisateur appartenant à la Nouvelle Vague d’auteurs nippons apparue au milieu des années 90 et amateur de toute forme d’improvisation à l’écran (voir
Mother). L’improvisation, comme le soulignait Hippolyte Girardot, est récurrente lors des échanges entre Yuki et Nina, rien de plus normal lorsque le film donne la vedette à deux enfants : le cinéma n’est qu’un outil pour raconter une histoire, mais les enfants restent des enfants avec leurs expressions pleine de naïveté et une vision de la vie, du haut de leur 1m20, qui leur est propre. On ne peut pas le leur voler. Yuki est une petite fille franco-japonaise dont les parents sont sur le point de se séparer définitivement. Sa mère prévoit de partir avec elle au Japon pour s’y installer, malgré le refus de cette dernière. Elle n’a qu’une amie, Nina, petite parisienne au fort caractère. Son père ne comprend pas réellement cette idée saugrenue, pour lui, le Japon c’est un pays de fous. Les deux petites vont donc imaginer tout un tas d’idées pour convaincre les parents de Yuki de se remettre ensemble, mais la question de la séparation n’est pas aussi facile qu’une belle lettre rédigée par les deux enfants, colorée et pleine de gommettes, destinée à les convaincre. Comme tente d’expliquer Jun à sa fille, il est triste de se séparer, mais rester ensemble est sans doute pire. La gamine, du haut de ses yeux d’enfants, a du mal à concevoir une telle idée et à la réception de cette lettre, signée par la fée de l’amour, Jun fondra en larmes. Mais au contraire d’une tombée dans le larmoyant et les bons sentiments, la scène ne mènera à rien de très positif et engagera une conversation avec d’un côté la raison incarnée par la mère et la naïveté par la petite Yuki, le film ne cesse d’ailleurs de confronter au sein d’un même cadre, d’un même lieu, l’enfance et le quotidien délicat des adultes pour une explosion d’émotions attendue, à l’image d’un orage provoqué par un choc de températures contraires.

Les deux inséparables ne vont bientôt plus l'être...
Mais
Yuki et Nina n’est pas qu’une chronique sur l’enfance et le couple, installée dans les beaux quartiers de Paris qu’une sitcom n’aurait pas renié. Il y a une magie enfouie derrière l’image lisse et élégamment photographiée, privilégiant des plans sans coupe pour affirmer l’authenticité et le naturel qui priment sur tout autre facteur. Car c’est en partie par le charisme de Yuki que le film prend régulièrement son envol et provoque le ralliement du spectateur à ses côtés, Nina ne reste qu’une petite fille aimable mais trop insolente. Néanmoins, la fugue qu’elle entreprend dans le dernier tiers la montre sous un jour nouveau, plus délicat et moins fonce-dedans à la manière d’un trente-tonnes lâché sur la Route 66. Elle prend l’initiative de mener la barque, file en compagnie de Yuki vers la maison de son père car toutes deux sont enfants de parents divorcés ou sur le point de l’être, et c’est parti pour l’aventure en forêt, représentant souvent une figure métaphorique de l’évasion. D’ailleurs, au moment où les deux petites se perdent de vue, Yuki se retrouve seule, livrée à elle-même, se frayant un chemin parmi les feuillages ou comment mettre en image son propre parcours initiatique, sa propre manière de grandir par la débrouillardise. Le film basculera à cet instant dans un autre monde, exacerbant s’il était encore nécessaire l’approche fantastique –au sens propre- de son récit : ou comment rappeler également une certaine idée du cinéma de Kawase Naomi et ce rapport très fort entretenu avec la nature et le spirituel.
Yuki et Nina culmine alors vers des sentiers qu’on ne soupçonnait guère, et en quittant Paris, livre une fable encore plus douce et rassurante sur l’avenir de la petite Yuki en compagnie de, qui sait, ses futures amies et une grand-mère plus familière qu’elle n’y paraît. Le spectateur pas tout à fait familier avec ce genre d’audaces narratives, très proches du songe, n’y trouveront qu’un film « superficiel » comme s’offusquait mon voisin de droite durant la projection de Et là-bas quelle heure est-il ? de Tsai Ming-Liang. Il n’y comprend tout simplement rien ou n’est pas encore prêt à comprendre ce style de procédé distordant le temps et l’espace sans prévenir. On ne lui conseillera pas le cinéma de Weerasethakul non plus. Ce beau portrait de l’enfance n’a rien à voir avec ces comédies US où les mômes finissent par faire réconcilier leurs parents à coups de baguette magique, et dieu merci le happy end n’est pas de la partie. La vie suit logiquement son cours, de manière attendue, comme cette pluie légère s’abattant sur les régions humides et verdoyantes du Japon auquel le film nous y convie, pour un dernier moment entre poésie et magie nébuleuses.
Courts-métrages
Écrasés par le
Diplomacy de John Goldman qui aura conquis le public d’entrée, le reste de la sélection semblait faire immédiatement pâle figure malgré le géni du
Muto de Blu, petite perle d’animation créative venue d’Italie. Et l’Asie, dans tout cela ? Pas grand-chose à se mettre sous la dent, pas même la dernière réalisation d’un Tsai Ming-Liang à côté de la plaque dont le déplacement au Louvres pour assister à une rétrospective de son œuvre vaut cent fois plus le coup. On trouvait bien quelque chose d’hypnotisant mais minimaliste avec le vague
Love Suicides du cinéaste malais Edmund Yeo.
Love Suicides, Malaisie.
Dans un petit village de pêcheurs perdu en Malaisie, une mère ne s’occupe plus de sa fille au fur et à mesure qu’elle reçoit des lettres plutôt étranges envoyées par son mari, absent depuis un certain temps. Dans ces lettres, le mari lui ordonne de ne plus chausser sa fille avant d’aller à l’école ou de ne plus lui faire à manger. Métaphore de l’autodestruction et de l’absence de communication,
Love Suicides au titre plus que suggestif, emporte le spectateur dans son silence destructeur entre poésie pessimiste et constat de l’état de santé d’une région vivant de ses propres ressources, à l’abri des gratte-ciels. Librement inspiré d’une nouvelle de Kawabata Yasunari.

Tout n'est qu'éphémère...
Madam Butterfly, Taïwan.
On trouve en tout cas bien plus de cinéma dans ce court d’un plus de dix minutes que dans la demi-heure du dernier Tsai. Madame Butterfly, dernière création en date de Tsai Ming-Liang, pose des questions sur le statut d’être metteur en scène à l’heure où quiconque s’accapare d’une caméra s’autoproclame cinéaste. Tant mieux puisque les technologies modernes permettent à n’importe quel péquin de tenter l’aventure et de laisser libre cours à la création. Malheureusement, Madame Butterfly démontre qu’avec une véritable économie de moyens, un format court et un scénario offrant à l’interprète un jeu en total roue libre, il est possible de se vautrer littéralement ou de faire preuve de qualités frôlant, et c’est une première, le néant. Madame Butterfly c’est la négation même de l’art cinéma, le pire de la prétention venant d’un cinéaste qui n’a pourtant plus grand-chose à prouver et qui se révèle être qui plus est magicien avec plus d’un tour dans ses chaussettes. Le passé l’a déjà démontré avec des œuvres aussi originales que profondément ancrées dans un réalisme social effrayant. Ce court-métrage est quant à lui ancré dans un centre-commercial et visiblement nulle part ailleurs : en dépit de son long plan-séquence de près de vingt minutes (petit joueur, The Magicians l’étire sur 90mn avec des idées de cinéma en pagaille) forçant le respect, il aurait au moins fallut cadrer correctement pour forcer l’admiration, au pire l’étonnement avec ce genre de procédé. La caméra piéton n’a jamais aussi bien porté son nom, pour les étincelles visuelles il faudra se lever tôt et changer de salle, l’esbroufe n’est même pas de la partie pour sauver un film nanti d’un scénario écrit en 15 secondes :
 Femme d’âge mûr – perdue dans un centre - fauchée – mal de gorge – veut prendre le bus – au lit.
Femme d’âge mûr – perdue dans un centre - fauchée – mal de gorge – veut prendre le bus – au lit.
A partir du moment où Tsai Ming-Liang fait de l’errance les bases de son cinéma, faut-il encore que cette thématique puisse exposer autre chose qu’une femme perdue dans un centre-commercial, attendant patiemment son mari. On a déjà vu plus fin dans la représentation de la solitude à l’écran, une solitude transformée en ennui pour le spectateur au départ sûrement intrigué par ces mouvements de foule, attraction principale, mais rapidement fatigués par ce film qui ne raconte rien et qui fait preuve dans le fond d’une telle oisiveté qu’il en est presque complaisant : le dernier plan (deux au total) dans la chambre de la femme n’est ni élégant ni porteur de sens. Après l’effort de l’errance et du mal de gorge, le réconfort ? Quelle générosité. Mais l’on s’est trompé dès le départ, Madame Butterfly étale sur le visage à moitié endormi du spectateur abandonné, presque trahis, sa médiocrité la plus effarante et ses cadres qu’un Marcel en vacances aurait également pu signer sans trop de soucis. Simplement incompréhensible.
Focus : les débuts de Nuri Bilge Ceylan (Turquie)

Nuages de mai
On aura plus vite fait de se tourner vers la rétrospective consacrée à l’excellent cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan, avec la projection notamment de ses deux premiers films, deux perles humanistes rappelant le cinéma de Abbas Kiarostami avec
The Small Town (projeté en copie 35mm unique) et
Nuages de mai. Deux films très ancrés dans la force de la nature, visuellement hypnotiques bien que très différents. Si le premier est tourné en noir et blanc, le second offre de remarquables couleurs pleines de chaleur à l’image des protagonistes du film. Un noir et blanc pour le premier donc, évoquant le souvenir, l’enfance, une peinture autobiographique d’un cinéaste évoquant sa jeunesse avec une poésie rare : les enfants jouant avec une plume en plein vol dans leur salle de cours est le signe le plus pur et le plus simple de la symbolique de la légèreté et de l’insouciance. Toute la force des deux premières œuvres du cinéaste se résume à la simplicité des métaphores, jamais assénées avec lourdeur, aux petites symboliques grandes de signification comme la neige pour évoquer le souvenir, le métier de cinéaste dans
Nuages de mai pour évoquer la passion grandissante de l’art cinéma chez Nuri Bilge Ceylan que l’on pourrait voir effectivement à travers le rôle de Muzaffer Özdemir. Et ces petits détails, ces petites scènes du quotidien à la fois graves (le petit garçon de
The Small Town qui retourne la tortue, incapable de survivre dans ces conditions) et merveilleuses de nostalgie (les tomates et les gadgets musicaux de
Nuages de mai) contribuent à bâtir les fondations d’un cinéma qui sera pourtant tout autre à partir de
Uzak, réalisé 4 ans après
Nuages de mai et première grande réussite festivalière du cinéaste désormais abonné à ce genre d’évènements, ses trois derniers films ayant tous été en compétition officielle à Cannes.
Finalement...
 See you next year...
See you next year...
Au final, l'Asie est repartie bredouille. Mais le spectateur venu faire le déplacement s'en fiche. Et si nous n’avons pas pu tout voir par manque de temps ou à cause d’une organisation parfois fébrile, le festival a tenu l’ensemble de ses promesses. On se demande toutefois comment le cinéma mk2 Bibliothèque n’a pas pu offrir ses plus grandes salles pour des évènements qui auraient pu faire salle comble, laissant quelques spectateurs au guichet face aux écrans supérieurs annonçant « séance complète ». De plus, la possibilité de pouvoir réserver des séances longtemps à l’avance est une hérésie dans la mesure où il est difficile de savoir concrètement si le spectateur pourra assister aux séances, sinon par simple mesure d’être sûr d’avoir un siège. Résultat, des séances affichant « complet » disposent encore de sièges libres. Ce n’est pas bien méchant, certes, mais c’est assez navrant pour les courageux se déplaçant sur la capitale uniquement pour assister à une séance en particulier tandis que pépère et mémère, ayant réservé leurs places à l’avance, se désisteront au dernier moment pour aller voir le Tour chez leur copine Yvonne. Quoi qu’il en soit, un tel évènement dans la capitale ne peut qu’être qu’accueilli à bras ouverts par la planète cinéphile ou les simples curieux d’une semaine.
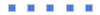
 On peut émettre des réserves sur le caractère du film. Pas le caractère qui lui est propre, entre rage non soutenue et constat navrant d’une société qui connait la crise –de nerfs, mais le caractère général de l’œuvre, sa faculté à libérer les coups à un rythme fatiguant, à enchaîner les mots doux avec un certain dynamisme. C’en est presque de l’art à ce niveau. L’art de la vulgarité formelle, des mots, du corps. Mais pourtant, outre cette manie de balancer le spectateur de gauche à droite en le foutant sur les murs comme un petit caïd qui menacerait le premier faible du coin, Breathless cache une sensibilité évidente, une haine due en partie à quelque chose, quelqu’un, quelque part. Yang Ik-Jun lâchera quelques pistes au fur et à mesure que le film avance et que ses personnages distribuent des coups, un procédé pas de plus innovants mais collant bien au style du film vidé de toute substance saine. A l’image de ses personnages marginaux supportant la crise, le spectateur prend un coup sur la tête face au filmage secoué, salement enivrant, parfois brouillon lorsqu’il tente de coller au plus près des personnages. On pourrait donc crier au manque de distance face à ceux qu’ils vivent, comme une sorte de complaisance/voyeurisme fait attraction malsaine. « Voyez ce que je dépeins, c’est sale et pas joyeux, hein ? », une réplique digne du premier peintre de réalisme social venu pour vendre son tableau en y ajoutant de grosses touches de pathos parce que sinon ça ne se vend pas. Pas assez « frappe à l’œil », pas assez coréen non plus vu qu’on ne pleure pratiquement pas de tout le film malgré tout le poids sur les épaules des personnages. La jeune Yeon-Hue doit supporter un père handicapé refusant la mort de sa femme et un petit frère autoritaire et influençable, elle trouve en Sang-Hoon une sorte de père/petit ami capable de la faire sortir du trou d’où elle vit ; c’est aussi pour cela qu’ils s’arrangent souvent pour aller boire un verre quelque part pour fuir le monde dans lequel ils vivent, tous deux partageant en quelque sorte les mêmes blessures familiales issues de la violence ou d’accès de folie. Dispersés ça et là dans le récit, les flash-back sont à ce stade bien employés.
On peut émettre des réserves sur le caractère du film. Pas le caractère qui lui est propre, entre rage non soutenue et constat navrant d’une société qui connait la crise –de nerfs, mais le caractère général de l’œuvre, sa faculté à libérer les coups à un rythme fatiguant, à enchaîner les mots doux avec un certain dynamisme. C’en est presque de l’art à ce niveau. L’art de la vulgarité formelle, des mots, du corps. Mais pourtant, outre cette manie de balancer le spectateur de gauche à droite en le foutant sur les murs comme un petit caïd qui menacerait le premier faible du coin, Breathless cache une sensibilité évidente, une haine due en partie à quelque chose, quelqu’un, quelque part. Yang Ik-Jun lâchera quelques pistes au fur et à mesure que le film avance et que ses personnages distribuent des coups, un procédé pas de plus innovants mais collant bien au style du film vidé de toute substance saine. A l’image de ses personnages marginaux supportant la crise, le spectateur prend un coup sur la tête face au filmage secoué, salement enivrant, parfois brouillon lorsqu’il tente de coller au plus près des personnages. On pourrait donc crier au manque de distance face à ceux qu’ils vivent, comme une sorte de complaisance/voyeurisme fait attraction malsaine. « Voyez ce que je dépeins, c’est sale et pas joyeux, hein ? », une réplique digne du premier peintre de réalisme social venu pour vendre son tableau en y ajoutant de grosses touches de pathos parce que sinon ça ne se vend pas. Pas assez « frappe à l’œil », pas assez coréen non plus vu qu’on ne pleure pratiquement pas de tout le film malgré tout le poids sur les épaules des personnages. La jeune Yeon-Hue doit supporter un père handicapé refusant la mort de sa femme et un petit frère autoritaire et influençable, elle trouve en Sang-Hoon une sorte de père/petit ami capable de la faire sortir du trou d’où elle vit ; c’est aussi pour cela qu’ils s’arrangent souvent pour aller boire un verre quelque part pour fuir le monde dans lequel ils vivent, tous deux partageant en quelque sorte les mêmes blessures familiales issues de la violence ou d’accès de folie. Dispersés ça et là dans le récit, les flash-back sont à ce stade bien employés. 









