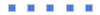Entretien avec Kim Jee-woon

Kim Jee-woon – à deux pas des Champs-Elysées – le 24 novembre dernier
Aurélien Dirler – Pourriez-vous tout d’abord nous expliquer comment vous en êtes arrivé à faire des films et revenir sur vos débuts en tant que réalisateur ?
Kim Jee-woon – En fait, pendant dix ans, je n’ai pas travaillé, j’étais en quelque sorte « chômeur ». À la fin, j’avais une copine avec laquelle j’avais été pendant deux ans, et finalement nous nous sommes séparés. Je me rappelle : c’était une nuit où il pleuvait, j’avais pris la voiture et je suis tout à coup entré en collision avec la voiture qui était juste devant. À l’époque, je n’avais pas d’argent, et je me suis mis à écrire deux scénarios… Et il se trouve que les deux scénarios ont été primés, ce qui m’a permis, avec le second, qui était celui de « The Quiet Family », de débuter dans le cinéma et de faire un premier film. Donc, en fait, j’ai perdu une copine, mais en même temps, j’ai trouvé le cinéma.
Vous passez d’un genre à l’autre : comédie, film horrifique, film noir, western… Est-ce que vous aviez des modèles en particulier, ou souhaitiez-vous simplement vous confronter à des genres très différents pour trouver une sorte de voie ?
Je ne sais pas s’il y a d’autres réalisateurs que moi à avoir essayé autant de genres différents au cours de leur carrière. Mais je dirais, en ce qui me concerne, que je suis à une étape où je recherche ce que je fais de mieux pour savoir ce qui me plait et ce qui m’excite vraiment. Je dirais que c’est un petit peu comme les gens qui voyagent : il y a certaines personnes qui préfèrent retourner aux endroits où elles vont tout le temps, tous les ans, pour se sentir à l’aise, alors que d’autres partent vraiment vers l’inconnu, pour découvrir ce qu’ils peuvent trouver dans certains pays. Moi, je fais partie de ces gens-là, qui aiment l’inconnu et qui veulent découvrir de nouvelles choses. Ainsi, je suis en train de chercher quel sera le bonheur ultime, le genre de film qui m’apportera le plus de satisfaction et de bonheur. Donc, à partir de maintenant, si jusqu’ici j’ai essayé de chercher, de me trouver, je pense que les prochains films seront un petit peu plus matures et je pense que je vais passer à l’étape supérieure.
On ressent une touche personnelle importante dans vos films. Il y a presque une réinterprétation des différents genres. Quelle est l’importance des codes des genres – des conventions – pour vous ?
En fait, dans les conventions des films de genre, je dirais qu’il y a deux sortes de conventions. Il y en a qui se répètent tout le temps, qui commencent à être un peu ennuyeuses, qui ennuient le spectateur parce qu’à force de répétition, on s’en lasse et on en a marre. Alors qu’il y a une deuxième sorte de conventions qui en fait nous satisfont toujours, qui nous procurent toujours autant de plaisir, même après des années et des milliers de films plus tard, on continue à aimer ce genre de conventions. C’est par exemple, dans le western, le sable dans le vent, la caméra qui montre deux jambes écartées d’un cow-boy prêt à dégainer, les gens qui marchent très lentement, une porte qui grince, un face à face... Il s’agit de codes typiques du western, mais en même temps qui sont toujours excitants et toujours aussi drôles à voir, qui procurent toujours – en tout cas pour moi – autant de satisfaction après des années de visionnage de westerns. Je pense en tout cas – en tant que réalisateur de films de genre – qu’il est très important de faire la différence entre ces deux types de codes.
Et peut-on voir – notamment dans « A Bittersweet Life » – une volonté de redéfinir ces genres auxquels vous vous confrontez plus que de rendre hommage ?
Pour en terminer avec la question précédente, qui est en rapport avec celle-ci, je pense qu’il est très important de bien utiliser les conventions. Dans un film, il faut essayer d’amener le spectateur à entrer dans le film en lui ajoutant une espèce de style personnel et en même temps en mélangeant les codes avec cette touche personnelle. C’est quelque chose de très important quand on revisite ces films de genre. Pour moi, je définis toujours ça un peu comme une sorte de jeu de puzzle entre le réalisateur et les spectateurs.
Pour répondre à votre question, le film « A Bittersweet Life » revisitait un peu le film noir français, mais ce n’était pas non plus un simple hommage. En ce qui concerne « Le Bon, la Brute, le Cinglé », c’est la même chose. Comme vous pouvez le voir dans le titre, le film fait référence au western spaghetti, mais c’est à la fois un hommage, une parodie, et en même temps, je revisite ce genre-là. C’est un petit peu un mélange de tout cela. Et comme le titre l’indique, beaucoup de personnes pensaient que ce serait un film sous influence leonienne, mais beaucoup m’ont dit que c’était plus une sorte de western qui était revisité.
« 2 Sœurs » est le film qui vous a révélé au monde entier. C’est votre film qui divise le plus – certaines personnes n’y voyant qu’un film d’horreur tandis que d’autre l’ont plus pris comme un drame psychologique. Nous sommes dans une situation de schizophrénie au niveau du film en lui-même. Pouvez-vous nous éclairer en nous disant ce qu’il en est réellement ?
C’est très compliqué dans la mesure où il s’agit vraiment d’un mélange de ces deux aspects-là. Je voulais montrer que ce qui était psychologique, c’était en fait une maladie qui était inhérente à l’homme, à l’humain, et que cela pouvait refléter une sorte de monde horrifique. Donc, pour moi, c’était vraiment ces deux aspects-là que je voulais montrer dans le film, et montrer justement les traumatismes et les problèmes psychologiques que l’humain peut avoir, montrer que ces problèmes-là pouvaient vraiment virer dans l’horreur. Ce sont donc ces deux aspects-là qui sont présents dans le film.
Bong Joon-ho a tendance à mélanger différents genres en un même film – ce qui était très visible dès « Memories of Murder » – avec une présence assez forte d’un humour que l’on peut qualifier de burlesque. Comment vous situeriez-vous par rapport à son cinéma, et éventuellement par rapport à celui de Park Chan-wook – vos films semblant justement avoir pour trait commun le fait d’user d’un humour qui joue sur le burlesque ?
En tout cas, s’il y a une différence entre nous, c’est qu’il est certain que Park Chan-wook et Bong Joon-ho ne feront jamais un film tel que « Le Bon, la Brute, le Cinglé », c’est vraiment quelque chose dont je suis sûr. Mais il est vrai que nous aimons généralement les mêmes films, et il y a une époque où nous nous réunissions une fois par semaine pour discuter d’un film après l’avoir visionné tous ensemble, donc nous sommes effectivement très proches. Mais il est vrai que les critiques, aussi bien en Corée qu’à l’étranger, pensent qu’il y a une similarité entre nous, que nous partageons le même sens de l’humour, le même monde cinématographique, en disant bien entendu que nous avons chacun notre propre signature, mais il est vrai que je suis assez mal placé pour dire exactement ce qui nous différencie et ce qui fait que l’on apprécie les mêmes choses.
Par exemple, Bong Joon-ho, je pense qu’il ne ferait pas un film tel que « Le Bon, la Brute, le Cinglé » simplement parce qu’il n’aime pas les westerns. Et Park Chan-wook ne ferait pas un film pareil parce que cela l’ennuierait.
Tous trois réalisez maintenant des films avec des budgets très importants. Vous êtes devenus des auteurs majeurs, en quelque sorte les étendards du cinéma coréen à l’international. Ne craignez-vous pas qu’il y a ait une perte d’identité dans vos travaux ? Je ne parle bien entendu pas de qualité, mais vraiment d’identité…
Je ne sais pas pour les deux autres réalisateurs, mais en tout cas, en ce qui me concerne, il est vrai qu’il y a une certaine peur. Parce que, à un moment, un créateur qui arrête de créer ou qui n’arrive pas à avoir des idées, ça signifie son arrêt de mort. Je me pose donc souvent des questions, me demandant où est-ce que je vais et comment je travaille. Personne ne peut me le dire autour de moi, et il faut donc que ce soit une autoréflexion, il faut vraiment que ce soit moi qui m’ausculte minutieusement. Mais je pense que je suis assez objectif, donc j’ai un regard qui est quand même assez froid envers moi-même. Mais il est vrai que c’est une peur qui existe et je me pose souvent la question, pour essayer de rester assez créatif et de suivre ma voie.
Pour prendre un exemple, dans les cancers, ceux qui sont les plus dangereux, les plus sournois, ce sont ceux qui font que l’on ne souffre pas, que l’on n’éprouve pas de douleur, et qui se répandent dans le corps entier. C’est vraiment ce qui fait le plus peur et c’est justement de cela que j’ai peur : de quelque chose qui ne s’annonce pas et qui se répand petit à petit. Pour l’instant, je ne suis pas encore touché, mais il est vrai qu’il y a toujours une peur de ne pas être assez inspiré.
Quel est votre point de vue personnel sur la situation du cinéma coréen depuis la diminution des screen quotas ?
Au début, on pensait qu’avec la réduction des screen quotas, le cinéma coréen perdrait chaque année de plus en plus de parts de marché et cela s’est avéré vrai. Le nombre de films produits diminue d’année en année, et il y a de moins en moins de films qui engendrent des bénéfices. La production et les investissements sont gelés, ce qui fait qu’il est difficile pour les projets innovants de voir le jour. Ainsi, tous les doutes que l’on avait dans la profession se sont avérés justifiés et se sont concrétisés.
Quels sont vos souhaits pour l’avenir – pour le cinéma coréen, mais également à titre personnel ?
En fait, la force du cinéma coréen, quand on est en Corée, on ne la perçoit pas vraiment. Mais quand on est à l’étranger, que l’on regarde le cinéma coréen à travers les yeux d’un étranger, on voit en tout cas que, pour l’instant, pour le moment, la cinématographie la plus diverse et la plus drôle reste le cinéma coréen. Je fais donc confiance aux réalisateurs coréens car ils ont un style qui est vraiment très puissant, une touche vraiment personnelle, donc je pense que l’on peut faire confiance à ces jeunes réalisateurs et qu’il y a vraiment un espoir. Et en même temps, moi aussi j’espère pouvoir continuer à faire des films qui puissent justement les influencer et leur donner une sorte d’inspiration pour faire de meilleurs films.
Propos recueillis par Aurélien Dirler le 24 novembre 2008 à Paris.
Portrait réalisé par Eve Leal pour Cinemasie. Toute reproduction interdite.
Chaleureux remerciements à Pascal Launay et Kim Yejin.